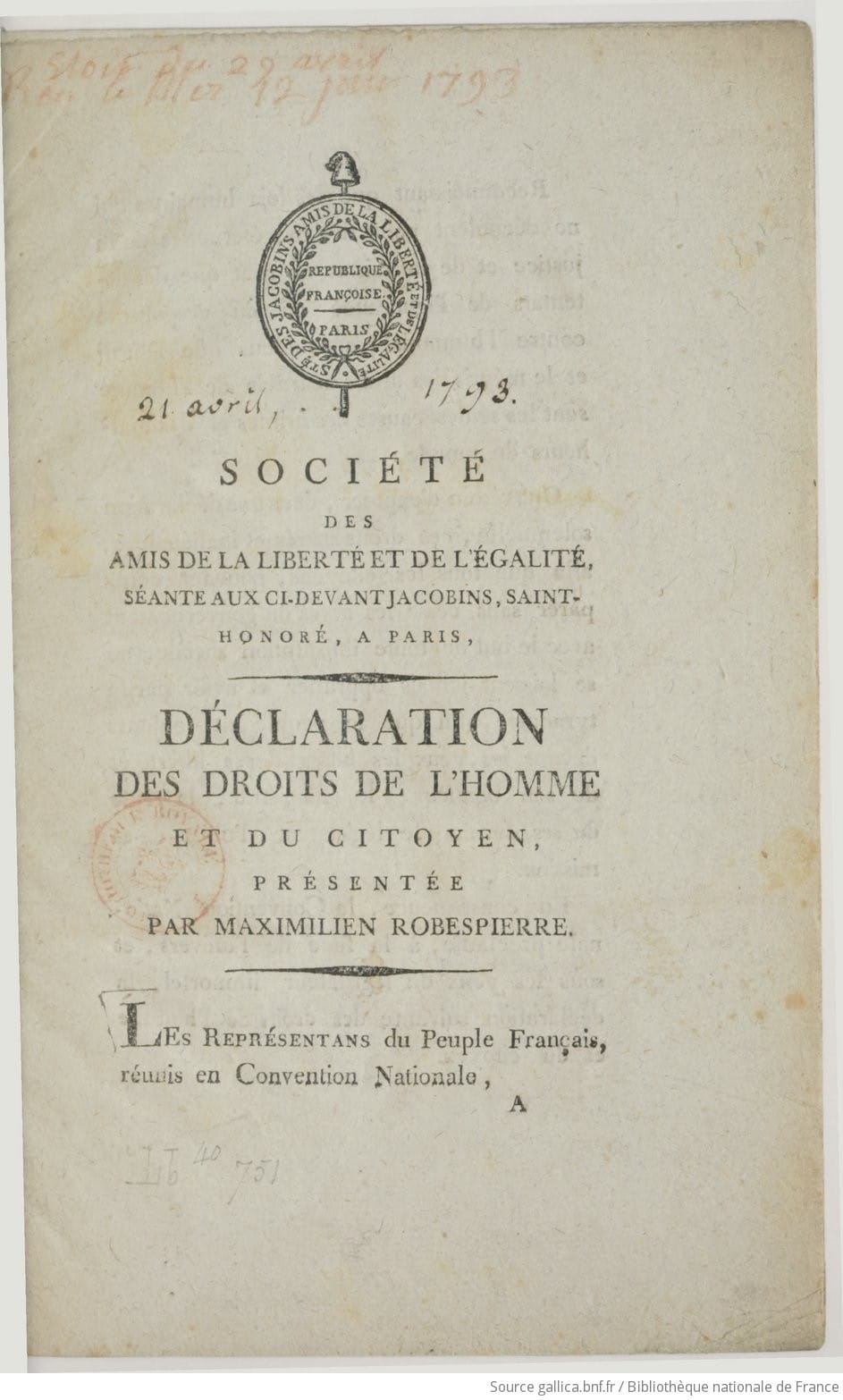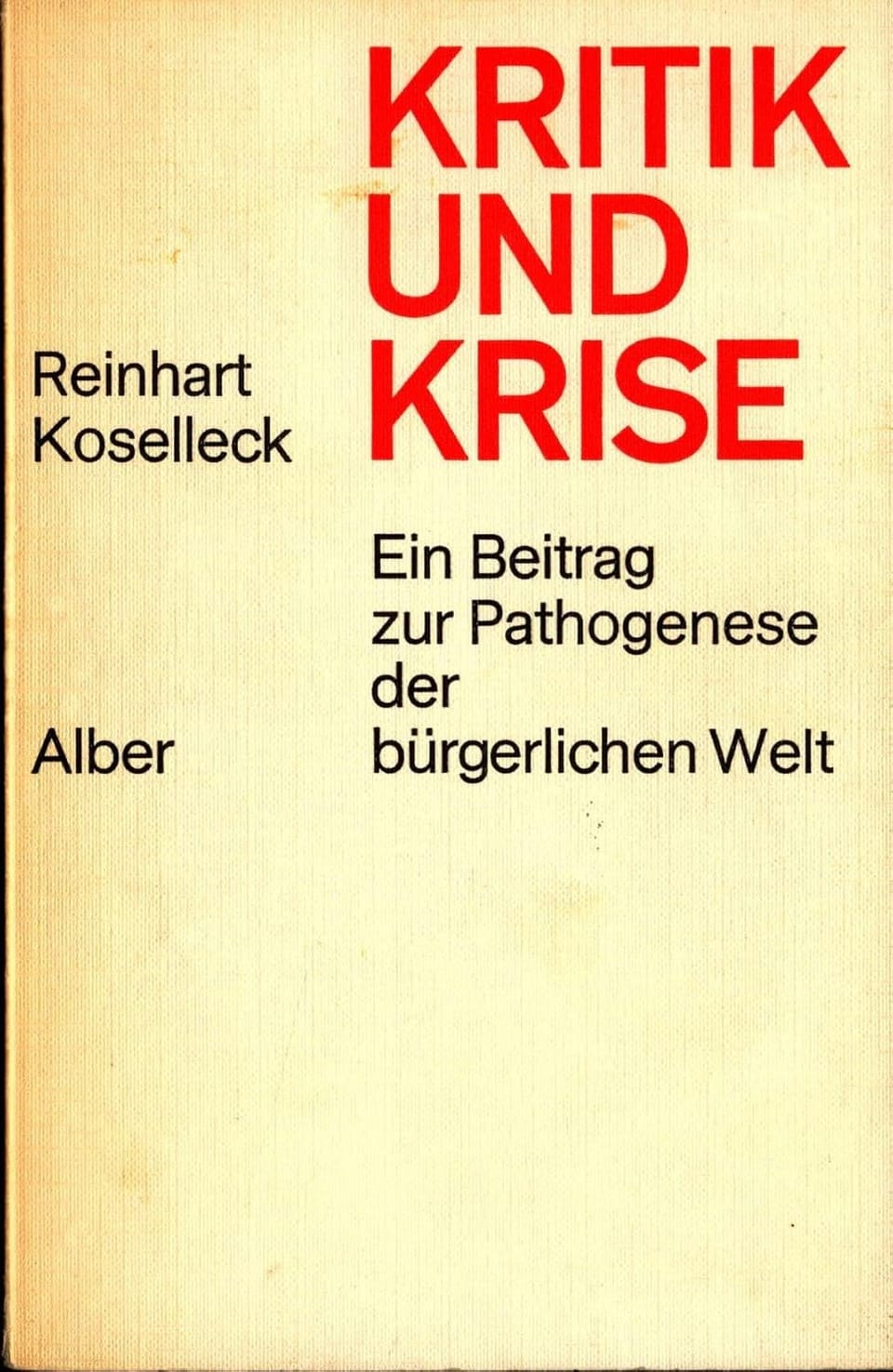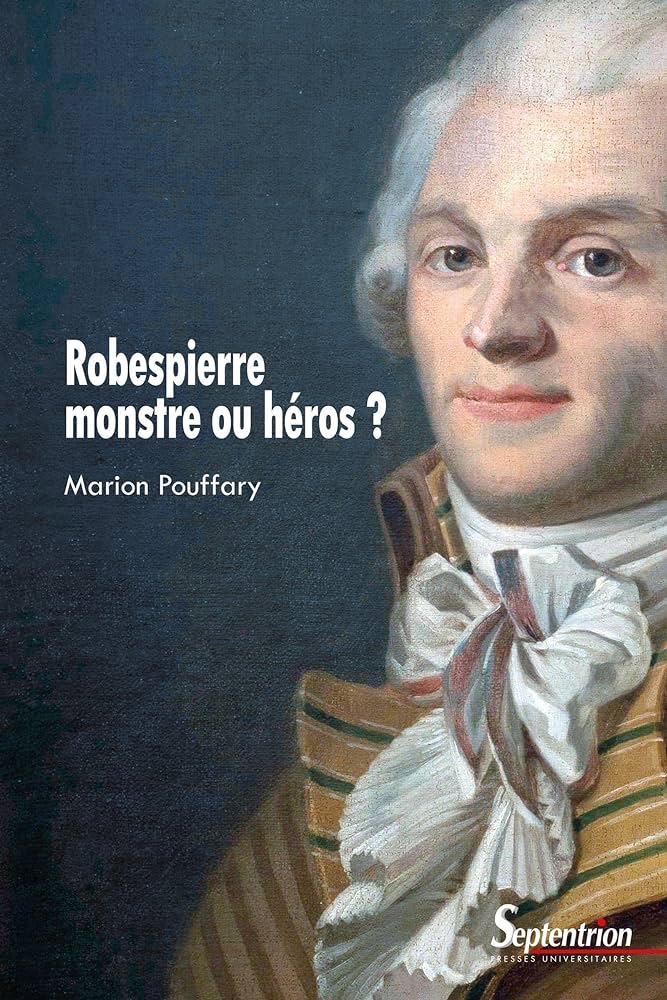La prud'homie des patrons-pêcheurs de Marseille pendant la Révolution française : principes républicains, droit à l'existence et préservation de la ressource
Par Yannick Bosc, GRHis, Université de Rouen-Normandie.

Texte publié dans Moissonner la mer. Économies, sociétés et pratiques halieutiques méditerranéennes (XVe s.- XXIe s.), Gilbert Buti, Daniel Faget, Olivier Raveux, Solène Rivoal (dir.), Paris – Aix-en-Provence, Khartala – MMSH, 2018, p. 211-224.
Cette étude s’inscrit dans une recherche collective sur les « communs »1 , au sens d’Elinor Ostrom, c’est-à-dire, si l’on suit la définition proposée par Benjamin Coriat, « des ensembles de ressources collectivement gouvernées, au moyen d’une structure de gouvernance assurant une distribution des droits entre les partenaires participant au commun et visant à l’exploitation ordonnée de la ressource, permettant sa reproduction à long terme »2. Ce dernier point concerne la célèbre thèse de Garrett Hardin3, dont Ostrom a fait la critique, thèse selon laquelle les communs seraient incompatibles avec la protection des ressources naturelles puisqu’ils engendreraient leur gaspillage et à terme leur épuisement. La prud’homie des patrons-pêcheurs de Marseille dont il sera ici question est un « commun » : elle est constituée autour de la ressource halieutique, dispose d’un règlement prud’homal – établi par la communauté – qui en fixe l’accès, la ressource étant gouvernée collectivement par l’assemblée des patrons-pêcheurs, dont le tribunal prud’homal est l’émanation. Contre Hardin, nous constaterons que la reproduction de la ressource à long terme est l’enjeu de ce dispositif4.
Ces « communs » pour lesquels l’intérêt renaît aujourd’hui, sont attaqués au XVIIIe siècle. Hardin et les néo-libéraux qui l’utilisent retrouvent en effet les théories des physiocrates fondées sur « l'esprit de propriété », théories selon lesquelles ce qui est commun est considéré comme « mal entretenu, pour la raison que ce qui appartient à tous n'appartient à personne »5. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’un des objectifs de ceux qui soutiennent ces idées et mettent en avant la liberté économique est d'éradiquer les « communs », considérés comme des archaïsmes médiévaux, qu’il s’agisse des communaux dans les campagnes qui sont un obstacle à la liberté illimitée du propriétaire, ou les communautés de métier – les « corporations », auxquelles se rattache la prud'homie des patrons-pêcheurs de Marseille – afin de garantir la liberté d’entreprendre entravée par les contraintes communes. Suivant cette logique, les corporations sont abolies pendant la Révolution française. Ce n’est cependant pas le cas de la prud'homie des patrons-pêcheurs de Marseille puisque sa juridiction est confirmée le 8 décembre 1790, la Constituante la désignant de surcroît comme un modèle d'organisation que les pêcheurs des autres ports méditerranéens sont engagés à imiter.
En quoi cette institution dite d’Ancien Régime, est-elle compatible en tant que « commun » avec les principes de la Révolution, formulés dans les Déclarations de 1789 et 1793, qui sont censés lui être opposés ?
Après avoir évoqué les raisons et les conséquences de la singularité prud’homale pendant la Révolution française, je m’intéresserai au règlement de la prud’homie et plus précisément aux justifications sur lesquelles repose la régulation de la pêche, des justifications qui s’inscrivent dans un discours républicain porté par le mouvement populaire et ceux qui le soutiennent.
Le républicanisme dont il sera question ici ne désigne pas principalement la défense d’ une forme constitutionnelle opposée à la monarchie (le gouvernement de plusieurs) mais celle d’une société d’êtres humains libres et égaux en droits – une république – tel que Thomas Paine par exemple le définit en 1791 : « Je n’entends point par républicanisme ce qui porte ce nom en Hollande et dans quelques États d’Italie. J’entends simplement un gouvernement par représentation ; un gouvernement fondé sur les principes de la Déclaration des droits6. »
Le maintien de la juridiction prud’homale
Le 28 octobre 1790, Imbert et Ardéni, prud'hommes, députés de la communauté des patrons-pêcheurs de Marseille accompagnés de Lombard, leur secrétaire-archiviste, se présentent à la barre de l’Assemblée nationale afin de demander le maintien de leur juridiction. Le mémoire qu’ils ont préalablement remis au comité de Constitution met en avant trois arguments principaux qui vont être validés par la Constituante.
Le premier a déjà été mobilisé lorsque l'utilité de la police des prud'hommes a été remise en cause entre 1776 et 1786 7. On le trouve en bonne place dans l’enquête sur les pêches de Chardon8 qui visite les côtes méditerranéennes en 1785 et intercède vraisemblablement en faveur de la prud’homie dont il accrédite le règlement en 17869. L’argument consiste à rappeler que l’État a intérêt à protéger le corps des marins pêcheurs qui contribue massivement au fonctionnement de la marine royale10. Les pêcheurs sont en effet astreints au service dans la marine en temps de guerre et estiment devoir être protégés en temps de paix. Leur sort, et donc celui de leur juridiction, intéressent la défense de l’État comme l'a compris l'ennemi héréditaire qui est judicieusement mobilisé dans l'argumentaire : « C'est en protégeant et multipliant les pêches que l'Angleterre travaille sans cesse à augmenter ses forces navales11. »
Le deuxième argument certainement décisif – qui a dû également peser en 1786 et explique la longévité de cette juridiction qui existe toujours – est technique. Il n’est pas possible de juger efficacement les contentieux en matière de pêche sans maîtriser la complexité du métier et du milieu dans lequel les pêcheurs évoluent :
« Les pêcheurs ont un langage particulier, et des expressions qui leurs sont propres. Chaque pêche a sa forme de procéder, ses limites, ses filets permis et réglés et ceux qui sont prohibés. Il est donc évident qu'il faut être pêcheur pour juger pareille matière, et on conviendra bien plus facilement de cette nécessité si l'on considère qu'il faut encore connaître les anses de la côte que les pêcheurs fréquentent, les lieux en pleine mer qu'on ne désigne souvent que par la citation d'un rocher caché au fond des eaux, et qui n'en a pas moins son nom ; les places où l'on a droit de prendre poste, et celles où il n'y en a point de convenu ; la distance qui doit être observée entre les filets respectifs et sur laquelle le juge ne peut être instruit que par des mesures propres aux pêcheurs seuls et que toute la théorie de la profession serait incapable de lui apprendre 12. »
Le troisième argument, sur lequel portera principalement cette étude, est fondé sur les principes de la Révolution. Depuis des siècles, les prud'hommes sont élus par leurs pairs et rendent une justice gratuite, ce qui fait des prud'homies une juridiction conforme à celle des « juges de paix » que l'Assemblée nationale a instituée quelques mois auparavant, le 16 août 1790. Le secrétaire archiviste décrit la prud'homie comme une juridiction « fraternelle » dans laquelle les justiciables élisent leurs juges, une juridiction qui, à l'image de celle des juges de paix, est « fondée sur les lois de la nature » et conclut : « si la juridiction des pêcheurs n'a pu être détruite dans des siècles de despotisme, quelle ne sera pas la durée des vôtres dans des siècles de liberté 13? » Les pêcheurs estiment donc – et l'Assemblée nationale les suit – que la juridiction de la prud'homie est « conforme aux principes actuels », c'est-à-dire ceux qui prévalent depuis le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, texte constitutionnel fondateur qui définit les normes du nouveau cadre juridique et politique. La justice prud'homale et le règlement des pêches qu'elle fait appliquer ne sont donc pas considérés comme des survivances passéistes mais s'inscrivent dans cette nouvelle normativité.
Le règlement prud'homal est à l'origine de nombreux conflits qui traversent l’histoire de la prud'homie au XVIIIe siècle, avant et pendant la Révolution française. Ces conflits concernent en particulier le feuilleton des palangriers catalans installés à Marseille depuis 1720, des pêcheurs qui ne reconnaissent pas la juridiction prud'homale14. La prud'homie reproche non seulement aux Catalans de ne pas payer la demi-part qu’elle doit normalement percevoir sur le produit des pêches, mais encore de ne pas respecter les règles du partage de l'espace, d'utiliser des appâts et des hameçons dont la taille et le nombre ne sont pas conformes au règlement.
La seconde grande source de conflits autour de la réglementation provient des « tartanaires », accusés comme les Catalans de mettre en œuvre des techniques prédatrices qui seraient à l’origine de la baisse des prises. Ces pêcheurs aisés qui peuvent investir dans du matériel coûteux, pratiquent la pêche « aux bœufs » avec des filets traînants, dit « filets bœufs », tractés par deux tartanes, une pêche qui est prohibée par la prud'homie mais que les tartanaires estiment avoir le droit de pratiquer.
Le 8 décembre 1790, comme l’avait déjà fait la monarchie avant 1789, la Constituante tranche en faveur de la prud’homie dont elle reconnaît le règlement, demande aux Catalans de le respecter et interdit la pêche aux bœufs. La juridiction devient par ailleurs un modèle que vont suivre les ports méditerranéens. Selon les termes de son décret, la Constituante rend « constitutionnels et communs à tous les pêcheurs du royaume des établissements qui, conciliés avec les principes du nouvel ordre judiciaire, leur rapprocheront toujours la justice, et les attacheront à une profession dont les plus grands intérêts sollicitent l'accroissement15 ».
L'Assemblée nationale ne confirme pas l'existence de la corporation elle-même avec ses propriétés, mais seulement celle de la juridiction du tribunal prud'homal, son principal attribut. Cela permet aux patrons-pêcheurs – concrètement ceux qui possèdent une embarcation et du matériel de pêche – de continuer, comme par le passé, à élire des prud'hommes, un secrétaire-archiviste, à « tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs », toutes choses qui caractérisent une association professionnelle et qui sont donc prohibées par l'article 2 de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 – dont cette dernière citation est tirée16 – , une loi adoptée six mois plus tard et qui ne s'applique donc pas aux prud'homies. Or, la loi Le Chapelier interdit les organisations professionnelles au nom des mêmes principes qui justifient le maintien de la juridiction prud'homale : l'article premier énonce que « l'anéantissement de toutes espèces de corporations » est « l'une des bases fondamentales de la Constitution française », et le quatrième que toutes les conventions entre les membres d'une même profession visant à entraver la libre concurrence sont « déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la Déclaration des Droits de l'Homme ».
La Constituante place la prud’homie entre deux lectures concurrentes des principes constitutionnels.
Le 8 décembre 1790, essentiellement pour des raisons pratiques, elle confirme l’institution prud’homale afin de préserver une justice très technique que seuls des professionnels de la mer peuvent maîtriser. Ce faisant elle inscrit le dispositif de régulation dont la prud’homie est la gardienne depuis des siècles, dans la normativité du droit déclaré en 1789 dont elle devient, quant à sa juridiction, la garante.
Cependant, pour des raisons idéologiques cette fois, la Constituante met en œuvre dans le même temps une politique qui lève toute entrave à la liberté économique – la loi Le Chapelier en est l’une des manifestations – que les Catalans ou les tartanaires peuvent légitimement convoquer afin de défendre leur liberté d'entreprendre et pour cela leur droit d’enfreindre le règlement des pêches qui la limite. En juillet 1790, afin de justifier leur rejet du règlement prud'homal, les Catalans s’appuient sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui selon eux – comme pour une majorité de Constituants – implique la libre concurrence, ce que l'on retrouve dans la loi Le Chapelier un an plus tard :
« Eh quoi ! Lorsque la Déclaration des droits de l'homme a consacré la liberté publique, lorsqu'elle a dit que la loi n'avait le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, lorsque l'abolition des corps a été prononcée par l'Assemblée nationale, appartient-il aux prud'hommes de mettre des entraves à une liberté qui existait sous l'Ancien régime ? De se créer une espèce de privilège exclusif et d'exercer contre l'intérêt public un monopole sur la pêche17 ? »
Les principes de la régulation
Pour ceux qui le contestent, le règlement prud’homal est une survivance des privilèges d’Ancien régime qui visent à entraver la libre concurrence et s’oppose aux principes de la Déclaration. Pour les prud'hommes au contraire le règlement est une condition nécessaire de la libre concurrence qui consiste à garantir à chaque pêcheur le droit égal à la liberté, inscrit dans la Déclaration. L'institution prud'homale participe ainsi d'une bataille d'arguments qui ne lui est pas spécifique, mais parcourt la Révolution française puisque celle-ci fonde ou refonde, en fonction des rapports de forces, les catégories du politique, et tout particulièrement la principale d'entre elles, celle de liberté.
Les arguments qui sont mis en avant par les prud'hommes afin de justifier le respect du règlement traitent de l’accès à la ressource dont dépend la possibilité d’exercer le métier et donc le droit à l’existence qui est la condition de la liberté. Ils sont consignés dans les registres des délibérations et concernent le contentieux avec les Catalans et les tartanaires mais aussi l'usage des filets fixes comme les thys et les battudes, le non respect des dimanches et des jours fériés, ou encore les pécheurs de Cassis qui calent leurs filets de manière permanente lorsqu'ils sont dans les mers de Marseille au lieu de se soumettre aux rotations qu'impose le règlement.
Il faut d’abord souligner que la masse des patrons-pêcheurs se distingue des quelques tartanaires aisés. Elle se vit comme « la classe la plus pauvre du peuple »18, et considère que sa principale caractéristique est la solidarité avec les plus démunis, non pas seulement une solidarité professionnelle que l’on retrouve à la source de toute organisation de métier. Les registres de délibérations soulignent qu'en dépit de leur pauvreté, sur laquelle ils portent l’accent, les pêcheurs contribuent régulièrement à des financements sous forme de dons – qui ne sont pas toujours désintéressés19 – ou d'emprunts municipaux20, notamment pour l'aide aux indigents. A l' échelle du métier, ils soutiennent les plus pauvres d'entre eux et reprochent aux Catalans qui refusent de payer la demi-part de ne pas participer à « la protection que peuvent demander tous les membres de la société » 21. Les revenus de la prud'homie, précise une délibération, doivent être utilisés pour soulager le pêcheur vieillard ou invalide, non dépensés en « dissipations » comme cela a pu être le cas lorsque que la prud'homie est tombée aux mains d'« administrateurs qui se perpétuaient eux-mêmes »22. Cette solidarité concerne également les matelots sans embarquement qui au cours de l’hiver 1790 refluent sur Marseille à la suite d'un désarmement à Toulon. La prud'homie indique à la municipalité qu’elle a déjà pris en charge certains d’entre eux « sur nos bateaux et bâtiments de pêche où ils partagent avec nos pêcheurs les mêmes travaux et les mêmes profits et nous leur avons offert [aux autorités municipales] de traiter aussi favorablement tous les autres pour leur donner le temps de trouver un embarquement sur un navire de commerce et les tirer jusqu'alors de la misère »23.
Avant comme pendant la Révolution française, le règlement est justifié par l'égalité. Sur le sujet sensible des tartanes par exemple, la jurisprudence prud’homale entre 1575 et 1754 vise à protéger les arts mobilisés pour la petite pêche afin de garantir un accès à la ressource pour les plus modestes : « Comme la tartane est le plus gros bâtiment de pesche tous les règlements enjoignent aux patrons de pesche de ne porter aucun domage aux autres arts et donc trainer leurs filets que dans certains endroits où les autres batteaux de pêche ne calent pas ordinairement24. » Quant aux Catalans, l'égalité est mise en exergue du Mémoire rédigé par Lavabre (1787), demandant une fois de plus qu’ils rejoignent la prud’homie : « Ce n'est pas à l'exclusion des Pêcheurs Étrangers qu'ils aspirent [les prud’hommes] ; c'est la paix et le bon ordre qu'ils sollicitent ; c'est une juste égalité ; et qui pourrait les trouver trop exigeants, ne ferait ni bon citoyen, ni bon Politique25 . » Après 1789, les prud’hommes articulent donc aisément le passé d’où vient le règlement au présent d’une Révolution qui en généraliserait les principes à l’ensemble de la Nation puisque, comme ils le font souvent valoir dans leurs jugements, « l'égalité est la base de notre profession ». Une délibération de 1790 s’appuie ainsi sur le règlement de 1557 qui limite les capacités de pêche et a été conçu afin de « prévenir que le plus riche n'envahit tout l'espace de la mer et ne priva celui qui aurait moins de moyens pécuniaires de l'avantage de faire la pêche ». La même délibération dénonce les pêcheurs « qui en s'arrogeant tous les profits et les avantages de la profession s'obstinent à en refuser le partage à ceux qui encourent également les dangers et qui ont au moins les mêmes droits d'y prétendre »26. En 1791, les prud’hommes rappellent la raison de la limitation des techniques de pêche que l’on trouve depuis plusieurs siècles dans les règlements : « On savait que le riche pêcheur pouvait employer un trop grand nombre de filets et envahir tout l'espace des mers dont il ne pouvait jouir qu'en partie et afin qu'il n'eut pas plus de droits que le pauvre on limita [les capacités des différents arts]. » C'est aussi « pour assurer toujours mieux l'égalité qui fait la base de notre profession » que le règlement impose aux pêcheurs un même point de départ afin de concourir au choix des postes de pêche 27. La même année, les attendus d’un jugement de pêcheurs aux thys qui emploient plus de filets que ne l'autorise le règlement précisent que « l'égalité qui a toujours fait la base de la profession exige que les pêcheurs n'emploient une plus grande quantité de filet les uns que les autres afin que chacun ait une égale jouissance des mers et que le riche n'ait pas plus de droits que le pauvre pêcheur »28. A l’automne 1792, le règlement est caractérisé comme « une loi excitée par l'égalité et par la vraie liberté »29, c’est-à-dire la liberté qui est régulée par l’égalité.
De manière concomitante, les contraintes réglementaires sont justifiées par la préservation de la ressource de telle sorte qu’elle puisse nourrir ceux qui en vivent, ce qui va de pair avec la limitation des capacités de pêche. Avant comme après 1789, l’argument est mobilisé contre la pêche aux bœufs « préjudiciable à l'industrie des pêcheurs et à la reproduction du poisson » qui « arrache les herbes marines qui servent d'abris et de retraite aux poissons de tout âge et toute espèce rompt et fait périr les lits de fray et cause un préjudice considérable à la pêche »30. C'est également la préservation de la ressource, plus que le respect des pratiques religieuses, qui est mise en avant lorsqu'un pêcheur travaille un dimanche ou un jour de fête alors que le règlement l'interdit : « Vous avez toujours observé que chaque fois que nous avons eu la douleur de voir parmi les pêcheurs des hommes qui ont violé ces loys, nous avons eu pendant longtems une disette de poissons »31. Ces règles est-il précisé ne sont « pas étrangères à la politique car elles accordent à la nature ce dont l'ambition humaine peut être avare, les moments de repos précieux pour la reproduction du poisson, pour la santé du pêcheur et pour la conservation de ses filets »32.
Ce règlement « politique » permet de lutter contre l'intérêt particulier et l'égoïsme, contre la loi du plus fort, et a pour fonction de garantir le droit à l'existence du plus démuni. S'il n'y avait pas ces règles « la force prendrait bientôt la place des loix, une jouissance qui doit être commune ne serait plus que particulière, le riche et le vigoureux triompheraient du pauvre et du faible »33. Derrière le règlement ce n'est pas seulement la prud'homie qui est en jeu mais plus largement une idée du bien commun qu'il faut protéger, qui ne se limite pas à la mer mais touche à « l'ordre social ». Un jugement rendu en octobre 1792 dénonce ainsi ceux qui contreviennent au règlement« par un esprit d'avidité et nuisible à la chose publique » alors que« les hommes vivant en société doivent toujours subordonner leurs avantages particuliers à l'intérêt général, [...] toute action contraire à ce but doit être arrêtée dans ses effets pour ne point laisser introduire un vil égoïsme destructif de l'ordre social [...] »34.
Un « commun » dans la république
Au XVIIIe siècle, les pêcheurs de la prud'homie ont pleinement conscience que la mer, parce qu'elle est un bien commun, implique une réglementation très précise de ses usages sans laquelle elle risque de ne plus être une « chose publique » disent les pêcheurs – ne plus être une res publica –mais une chose privée que les plus riches accaparent aux détriments des plus pauvres et de la ressource qui est pillée. Selon les délibérations qui justifient cette réglementation, la meilleure manière de préserver la ressource consiste d’abord à fixer les normes de son usage sur les besoins des plus pauvres. Le fait que le plus faible puisse avoir sa part, en d’autres termes que son droit à l’existence soit garanti, induit en amont un contrôle des prédateurs potentiels et donc une protection de la ressource dont dépend l’activité et donc la subsistance.
Les prud'hommes ne se situent pas seulement dans le cadre étroit du métier, mais relient les conditions de son exercice à des questions d'intérêt général, des questions de « politique » selon leurs termes. On constate ici une évolution. Cette montée en généralité est assumée par les patrons-pêcheurs en 1791-1792, alors qu'elle leur semble illégitime lorsqu’ils rédigent leurs doléances pour les états généraux de 1789: « Nous vous proposons de laisser aux classes supérieures et plus instruites le soin de porter leurs doléances sur des objets au-dessus de nos connaissances, et de nous borner à ce qui nous touche de plus près comme patrons-pêcheurs et comme pauvres35. »Au fil des événements qui déploient la « logique immanente » des principes de la Déclaration, selon l’expression de Groethuysen36,les patrons-pêcheurs mobilisent plus fréquemment le lexique révolutionnaire. On le constate en particulier dans les extraits des délibérations de 1792 cités précédemment37.
Ce fait est moins la manifestation d’un conformisme, ou d’une acculturation, que l’expression d’une langue politique en train de s'élaborer38,dans un moment où les principes de sens commun entrent en résonance avec le langage de la loi. Ces principes sont, écrit Kant, les« droits naturels dérivant du bon sens commun »39, ils sont inscrits dans la Déclaration et avant cela dans le cœur des hommes, comme on le souligne communément pendant la Révolution, ils sont dans la vie, dans les pratiques avant d’être dans les livres. C’est également cette origine qui est attribuée à la réglementation prud’homale dans le mémoire présenté à la Constituante : « Leur code est dans leur cœur et dans la pratique qu'ils ont des procédés de la pêche40 », ce qui justifie une juridiction particulière, nous l’avons noté. Dans un développement sur la police des pêches de novembre 1791, ce code est explicitement renvoyé à une normativité des« lois de la nature » :
« L'égalité les a fait naître [les « règles générales » de la pêche], l'égalité doit les conserver aux pêcheurs. Partout où les lois conventionnelles ont été d'accord avec les lois de la nature la prospérité et le bonheur public ont été le signe et la récompense de ces accords. Ces précieux avantages résident évidemment dans les dits règlements. Eh ! Pourrait-on jamais substituer d'autres règlements à ceux qui se conciliant avec le bien général assurent à tous les pêcheurs les mêmes droits qui ont prévenu tous les abus et partagé impartialement la jouissance d'un élément dont la terre seule paraissait susceptible41.»
Les fondements du règlement des pêches sont aussi ceux du pacte social, selon lequel« le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme » (article 2de la Déclaration de 1789), une autre manière de dire que « les lois conventionnelles »(de l’association politique) doivent être en accord avec « les lois de la nature » (en conservant les droits naturels de l’homme).
Les délibérations mettent donc en avant trois niveaux de biens communs qui sont articulés les uns aux autres : la ressource halieutique – et au-delà la mer – , la prud’homie (le métier et sa régulation) et « l’ordre social » généré par un état social constitué d’êtres humains libres et égaux en droits, en d’autres termes la république. La prud’homie est un mode de gouvernement de la ressource qui repose sur les mêmes principes que le mode de gouvernement du bien commun-république, la république et la prud’homie étant à la fois un bien commun et le mode de gouvernement de ce bien commun.
La régulation du bien commun, que ce soit la mer, la prud’homie elle-même ou au-delà la société commune, passe par la mise en œuvre de l'égalité en droit. Un droit égal à la liberté est la condition nécessaire de la liberté. La« vraie liberté » évoquée dans une délibération de 1792 est donc conçue comme un rapport social : je suis libre parce que les autres le sont également. Ce droit égal à la liberté correspond à l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». Nous sommes toujours en présence des principes de sens commun, en l’occurrence ce que l’on nomme « la Règle d’Or »(« Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse » ) sur laquelle s’ouvre de Decretum de Gratien (XIIe siècle) dont Brian Tierney montre qu’il est l’origine de la tradition du droit naturel42. Cette liberté n’est pas caractérisée par une absence d’entrave mais par sa réciprocité43. Elle correspond à la liberté comme non-domination de la tradition républicaine44. Al'échelle de la prud'homie, le règlement constitue un contrat qui définit un espace de réciprocité permettant à chacun, riche ou pauvre, d'avoir les mêmes droits sur la ressource.
L’idée selon laquelle il faut que « règne cette égalité juste et nécessaire pour permettre à chacun de jouir de sa profession »45n’est pas particulière aux pêcheurs de la prud’homie ni à la Révolution française. Elle est à la base des communautés de métier depuis le Moyen Age, idéalement fondées sur une solidarité entre ses membres. La centralité du droit à l'existence dans la régulation des rapports sociaux est largement partagée par le peuple du XVIIIe siècle, que ce soit le monde des artisans ou la paysannerie, qui pendant la Révolution française forme la sans-culotterie des campagnes et des villes. Ils ont en commun ce que Thompson a nommé « l'économie morale »46, c'est-à-dire des normes traditionnelles de sens commun selon lesquelles le droit à l'existence est une limite à l'accumulation, la communauté étant garante de leur respect. C'est la raison pour laquelle, bien avant la Révolution française, la communauté villageoise et la communauté de métier sont considérées comme de petites républiques, au sens général de ce que l'on nomme le « bon gouvernement », celui qui idéalement doit permettre à tous les membres de la communauté de vivre en harmonie, cela n’excluant pas qu’elles soient traversées de très nombreux conflits.
Pendant la Révolution française, ce modèle républicain étendu à l'échelle de la Nation est défendu par le mouvement populaire et ceux qui le soutiennent47 – Robespierre par exemple qui le nomme « économie politique populaire » – pour lesquels les êtres humains, puisqu'ils sont égaux en droits, ne forment une république que si l'existence de tous ses membres est garantie et qu’ils en contrôlent l’effectivité. Cela signifie par exemple que les subsistances ne peuvent pas être abandonnées au marché mais sont une affaire politique.
En face, d'autres acteurs qui se réclament aussi des principes de la Révolution considèrent que le bon gouvernement est au contraire celui qui donne toute liberté aux propriétaires dans l'usage de leurs propriétés et aux entrepreneurs d'entreprendre, la poursuite de l’intérêt particulier étant favorable à l’ensemble de la société. Ils jugent ainsi que les réglementations qui entravent cette liberté sont illégitimes et freinent le développement de l'économie, d'où les lois d'Allarde et Le Chapelier. A Marseille, les partisans des pêcheurs Catalans expliquent qu'ils sont indispensables à l'économie locale car ils alimentent largement les marchés, ce qu'ils ne pourraient faire en étant bridés par les règles prud'homales. La liberté d'entreprendre et la déréglementation sont ici considérées comme indispensables pour accroître l'offre des subsistances.
Ces principes qui ont fondé les bases de l'économie productiviste ont dominé nos représentations du progrès pendant deux siècles et ont fini par engendrer notre monde qui met en danger le droit à l'existence de l'humanité. Aussi est-il important d'être attentif à des modèles alternatifs plus frugaux que l'on a longtemps opposés aux principes républicains et dépréciés parce qu'ils ont été disqualifiés au nom de cette idée du progrès indexée sur le productivisme. Les prud'homies de pêcheurs, en partie reconfigurées par la Révolution, ne fonctionnant pas sur le monopole et l’exclusion, jouant un rôle important dans la régulation économique et écologique des pêches et possédant un statut de droit commun qu’elles ont conservé jusqu’à nos jours48, constituent l’un de ces modèles.
Bibliographie :
CORIAT, Benjamin(dir.). Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire. Paris : Les Liens qui Libèrent, 2015.
FAGET, Daniel. Marseille et la mer. Hommes et environnement marin (XVIIIe-XXe siècle). Rennes : PUR, 2011.
HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science n° 3859, 1968, p. 1243-1248.
WEULERSSE, Georges. Le mouvement physiocrate. Paris : Alcan, 1910.
GAUTHIER, Florence. Triomphe et mort du droit naturel en Révolution (1789-1795-1802). Paris : PUF, 1992, rééd. Syllepses, 2014.
GROETHUYSEN, Bernard. Philosophie de la Révolution française. Paris : Gallimard, 1956,
GUILHAUMOU, Jacques. La langue politique et la Révolution française. Paris : Méridiens Klincksieck, 1989.
IKNI, Guy-Robert. La république au village en l'an II. in : VOVELLE Michel Vovelle. Révolution et République. Paris : Kimé, 1994, p. 252-262, rééd, Révolution Française.net, Décembre 2014.
PETTIT, Philip. Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement. (1997) trad. Paris : Gallimard, 2004.
SKINNER, Quentin. La liberté avant le libéralisme. (1998) trad. Paris : Seuil, 2000.
THOMPSON, Edward P. L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle. (1971), trad., In : GAUTHIER Florence et IKNI Guy R. La guerre du blé au XVIIIe siècle. La critique populaire contre le libéralisme économique au XVIIIe siècle. Paris : Ed. de la Passion, 1988, p. 31-92.
RAUCH, Delphine. Les prud’homies de pêche à l’époque contemporaine (1790-1962) : la permanence d’une institution hybride en Méditerranée française. Annales de la faculté de droit et science politique de Nice, 2014, p. 295-300.
TIERNEY, Brian. The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law, 1150-1625. Michigan/Cambridge UK : Eerdmans, 1997.
Notes :
1Projet EnCommun (Entreprendre en commun, droits de propriété, « communs » et entreprises ) coordonné par Benjamin Coriat, CEPN – Université Paris 13.
2Benjamin Coriat (dir.), Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015, p. 38.
3Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, Science, vol. 162, n° 3859, 1968, p. 1243-1248.
4Ce qui est toujours le cas aujourd’hui, voir le texte d’Elisabeth Tempier dans le présent volume.
5Dubois de Saint-Hilaire, Journal de l'agriculture, juillet 1767, cité par Georges Weulersse, Le mouvement physiocrate, Paris, Alcan, 1910, t.1, p. 410. Il s'agit d'une réponse à une consultation sur les communaux, lancée par la Société d'agriculture de Paris, auprès de ses correspondants. Dubois de Saint-Hilaire est le directeur du bureau de Brives.
6Le Républicain ou le défenseur du gouvernement représentatif par une société de républicains, Juillet 1791, n°3, p.52.
7En 1776, un arrêt du conseil suspend la juridiction des prud'hommes vis à vis des étrangers, ce qui concerne en particulier les pêcheurs Catalans qui ne veulent pas dépendre de la prud’homie. Cette compétence est attribuée à l'intendant de Provence qui, selon les patrons-pêcheurs marseillais, a intrigué pour cela. En 1786 un arrêt du conseil reconnaît l'insuffisance de l'intendant, proclame l'utilité de la police des prud'hommes, et leur restitue la partie de la juridiction dont l'exercice qui leur avait été retiré (« Mémoire sur la police de la pèche française présenté à l'Assemblée nationale par les députés des patrons-pêcheurs de Marseille », Archives Parlementaires, t. 21, p. 327). On peut supposer qu’il existe un lien avec la politique de Turgot qui supprime les corporations en 1776, mais à ma connaissance il n’a pas été étudié.
8Voir la contribution de Gilbert Buti et Sylviane Llinares.
9AD, BdR, 250 E 8, règlement du 26 décembre 1786 sur les filets.
10En 1786, Castries, le secrétaire d’État à la marine, réorganise la flotte française.
11« Observations sur le projet de décret remis au comité de Constitution par les prud'hommes des patrons-pêcheurs de Marseille », AP, t.21, p. 330.
12« Mémoire sur la police de la pèche... », op.cit, p. 328.
13AP, t.21, p. 74-75.
14Daniel Faget, Marseille et la mer. Hommes et environnement marin (XVIIIe-XXe siècle), Rennes, PUR, 2011.
15AP, t.21, p. 329.
16Article2de la loi Le Chapelier : « Les Citoyens d'un même état ou profession, les Entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les Ouvriers & Compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni Président, ni Secrétaires, ni Syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlemens sur leurs prétendus intérêts communs. »
17AM Marseillaise, 18 F 6, 10 juillet 1790, cité par Daniel Faget, op.cit., p. 85.
18AD, BdR, 250 E 43, 26 décembre 1790.
19Le 28 octobre 1790, le secrétaire-archiviste qui plaise la cause de la prud’homie devant la Constituante rappelle opportunément que les pêcheurs marseillais « vinrent avec empressement au secours de la nation que vous défendiez, mais avec le regret de ne pouvoir lui donner que la somme de 2,000 livres », AP, t. 20, p. 75.
20AD, BdR, 250 E 43, 26 décembre 1790.
21Ibid., 26 mars 1790.
22Ibid., 21 février 1790.
23Ibid., 26 décembre 1790.
24AD, BdR, 250 E 5, p. 71.
25Mémoire pour les prud'hommes de la communauté des patrons pêcheurs de la ville de Marseille, 1787, AD, BdR, 250 E 8.
26AD, BdR, 250 E 43, 26 mars 1790.
27AD, BdR, 250 E 44, 20 novembre 1791.
28Ibid., 7 août 1791.
29Ibid., 13 novembre 1792.
30Ibid., 16 août 1791.
31AD, BdR, 250 E 43, 2 janvier 1791.
32AD, BdR, 250 E 44, 20 novembre 1791.
33Ibid.
34AD, BdR, 250 E 44, 22 octobre 1792.
35Joseph Fournier, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Marseille pour les états généraux de 1789, Marseille, Imprimerie nouvelle, 1908, p. 207.
36Bernard Groethuysen, Philosophie de la Révolution française, Paris, Gallimard, 1956, p. 234-235.
37Le registre conservé sous la cote 250 E 44 comporte peu de délibérations pour l’année 1793 et les suivantes. L’influence de Ponsard, le secrétaire-archiviste qui tient la plume et joue le rôle d’un porte-parole, mériterait d’être étudiée.
38Jacques Guilhaumou, La langue politique et la Révolution française, Paris, Méridiens Klincksieck, 1989.
39Emmanuel Kant, Le conflit des facultés, trad. Gibelin, Paris : Vrin, 1973.
40« Mémoire sur la police de la pèche française… », op.cit, p. 326.
41AD, BdR, 250 E 44,20 novembre1791.
42Brian Tierney.The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law, 1150-1625,Michigan/Cambridge UK, Eerdmans, 1997.
43Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution (1789-1795-1802), Paris, PUF, 1992, rééd. Syllepses, 2014.
44Philip Pettit, Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, (1997), trad. Paris, Gallimard, 2004 ; Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme ,(1998), trad. Paris, Seuil, 2000.
45AD, BdR, 250 E 44, 8 mai 1791.
46Edward P. Thompson, L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, (1971), trad., in Florence Gauthier et Guy R. Ikni (dir.) La guerre du blé au XVIIIe siècle. La critique populaire contre le libéralisme économique au XVIIIe siècle, Paris, Ed. de la Passion, 1988.
47Guy-Robert Ikni, La république au village en l'an II »,in Michel Vovelle (dir.), Révolution et République, Paris, Kimé, 1994, p. 252-262, rééd, Révolution Française.net, Décembre 2014.
48Delphine Rauch, Les prud’homies de pêche à l’époque contemporaine (1790-1962) : la permanence d’une institution hybride en Méditerranée française, Thèse de droit, Université de Nice Sophia Antipolis, 2014, présentée dans les Annales de la faculté de droit et science politique de Nice, 2014, p. 295-300.