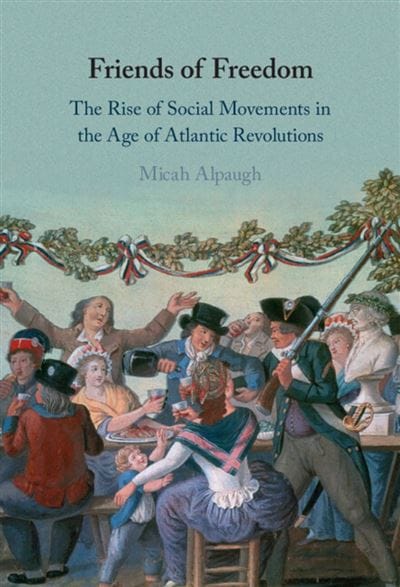Terreur, "Terreur", terreur etc. De quoi parle t-on ?
Par Yannick Bosc, GRHis, Université de Rouen-Normandie. A propos de l’ouvrage de Michel Biard et Marisa Linton, Terror: The French Revolution and Its Demons, Cambridge, Polity Press, 2021, préface de Timothy Tackett, 241 p.
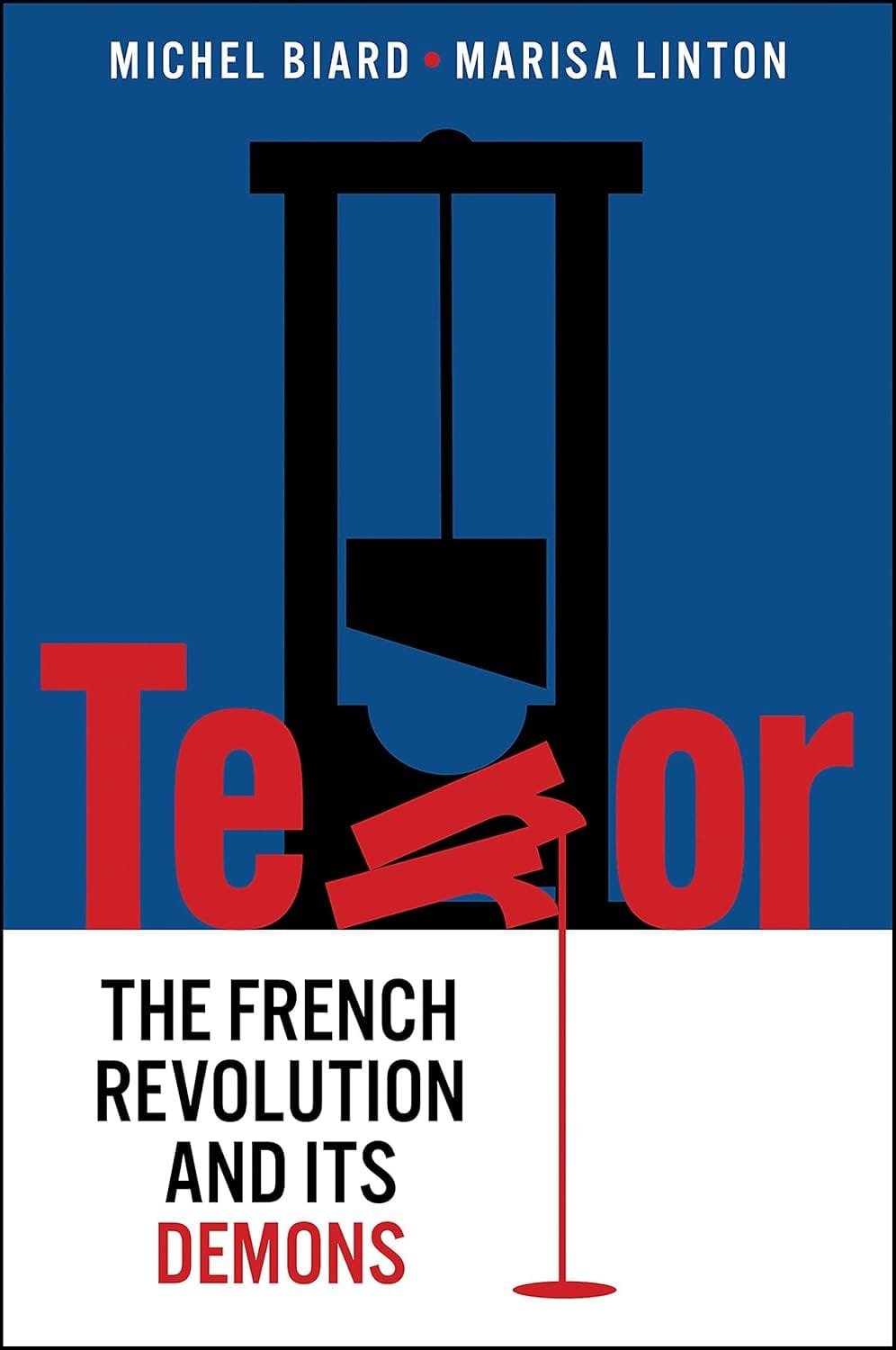
Dans cette traduction en anglais, raccourcie et remaniée d’un livre paru en français (1), Michel Biard et Marisa Linton proposent une mise au point sur la « Terreur » (grand T), un chrononyme qui est aussi une catégorie politique et l’une des catégories historiographiques les plus polémiques car elle ordonne les interprétations de la Révolution française et avec elle de la « modernité ». Au-delà, ils mobilisent l’histoire des émotions pour interroger l’articulation de la « terreur » (petit t) et de la « Terreur ». Nous verrons que la circulation entre les différentes acceptions et usages de la Terreur/terreur que proposent les auteurs est problématique. Les huit chapitres thématiques, la chronologie de la Convention et les cartes en annexe, composent un ensemble accessible aux non-spécialistes qui trouveront une synthèse des connaissances.
Les auteurs prennent d’emblée leurs distances avec les thèses classiques qui ont longtemps été dominantes. Ils tempèrent celle dite des « circonstances » qui à leur avis minore le rôle joué par les émotions (l’impact de la guerre civile et étrangère est loin de tout expliquer) et rejettent l’interprétation selon laquelle la terreur (petit "t") serait inhérente à la Révolution française et la matrice des totalitarismes du XXe siècle : « Robespierre n’était pas Staline » (p.3). Dans un contexte d’« exception politique », il s’agit de « saisir ce que signifie vraiment la terreur pour la génération révolutionnaire » (p. 5), d’en restituer la complexité et pour cela de ne pas la réduire à la violence comme c’est ordinairement le cas. Ils rappellent que les révolutionnaires ont eux-mêmes contribué à fixer les clichés en déployant une rhétorique et une imagerie spectaculaires en direction des ennemis de la république, notamment celle de la guillotine qui résume souvent la période (et qui illustre la couverture de l’ouvrage, le sang n’étant pas oublié).
Depuis le Bicentenaire, de nombreux travaux ont souligné que « La Terreur » est un concept thermidorien, ce que les auteurs mettent en avant. Le 11 fructidor (28 août 1794), un mois après avoir éliminé les « robespierristes » (un autre désignant thermidorien), Tallien stigmatise un « système de terreur » qui aurait été orchestré par Robespierre et ses « complices » (les « terroristes »), l’objectif étant en particulier de justifier leur élimination et de leur faire porter la responsabilité de la répression. Citant les débats de la Convention, Biard et Linton décrivent la construction de la catégorie de « Terreur », celle de la « légende noire » du « tyran » qui l’accompagne et montrent que s’il existe de nombreux usages du terme « terreur » depuis 1789 ceux-ci ne sont jamais reliés à un dispositif qui aurait constitué un « système » politique. Ils reviennent sur le mythe d’une Convention qui aurait mis la « terreur à l’ordre du jour » à la suite des journées populaires des 4 et 5 septembre 1793. Aux porte-parole des sections qui exhortent la Convention de retourner la terreur contre les ennemis de la liberté en la mettant « à l'ordre du jour », son président – en l’occurrence Robespierre, ce qui n’est pas précisé – répond que le « courage et la justice sont à l’ordre du jour », mais il n’est pas question de « terreur ». Les auteurs auraient également pu indiquer que le volet principal du mot d’ordre des sections (« la terreur est à l’ordre du jour ») concerne le contrôle démocratique du pouvoir exécutif (2). Cela aboutit à la loi du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) qui organise le Gouvernement révolutionnaire et attribue le pouvoir exécutif des lois révolutionnaires aux municipalités et aux comités de surveillance, ce qui peut justifier l’interprétation selon laquelle la terreur – mais pas au sens étroit d’un système répressif – aurait alors été mise à l’ordre du jour par la Convention.
Biard et Linton s’intéressent au sens de la « Terreur » (grand T) avant la Révolution et reviennent en particulier sur la problématique des Lumières comme origine de la Terreur. Cette thèse contemporaine de la Révolution a été retravaillée par les historiens dit « révisionnistes », autour de François Furet et Keith Baker, pour lesquels la volonté générale de Rousseau aurait une fonction matricielle dans ce qu’ils considèrent comme une dérive totalitaire de la Révolution (notons que cette interprétation est d’abord promue par Jacob Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, 1952, qui n’est pas cité). A la recherche de ce qui a pu construire les représentations des révolutionnaires, les auteurs interrogent (p. 28) le « concept de « terreur » sous l’Ancien Régime » (mais peut-on pour cette période parler de « concept » à propos d’usages multiples et dissociés ?). Biard et Linton notent que sous l’Ancien Régime, la connotation du terme « terreur » est positive, que ce soit la terreur salutaire inspirée par le Dieu de l’Ancien testament ou celle du roi protecteur de ses peuples et terrifiant pour les méchants, la terreur et les mises en scène théâtralisées des supplices étant un outil de la justice royale. Selon les auteurs, terreur et théorie politique seraient associées dans la tradition républicaine, la vertu politique préparant à être terrible au service de l’intérêt général, à l’image du héros classique qui, n’hésitant pas à se sacrifier et sacrifier les siens par amour de la patrie, attend une même abnégation des autres citoyens.
La dynamique de la peur et des émotions joue un rôle important pendant la Révolution comme de nombreux travaux – dont ceux de Marisa Linton – l’ont montré ces dernières années. Puisque l’enthousiasme est une émotion « considérée comme essentielle au succès de la Révolution » (p. 45), il aurait pu donner lieu à un développement, d’autant que Boissy d’Anglas, par exemple, dénonce l’enthousiasme pour condamner la « Terreur ». Biard et Linton soulignent à juste titre que la peur de la conspiration et de la trahison n’est ni particulière aux Jacobins, ni une caractéristique de leur supposée paranoïa. S’il existe des conspirations imaginaires, les complot sont biens réels, leur crainte étant accentuée par des événements aussi sidérants pour les contemporains que la fuite du roi ou encore la trahison de Dumouriez.
La "Terreur" étant associée à la répression, les auteurs reviennent sur la vertu politique (l’amour de l’égalité, selon Montesquieu), la lutte contre la vénalité et la réalité de la corruption, les représentants du peuple devant être exemplaires sont jugés bien plus sévèrement que les citoyens ordinaires, à l’exception de ceux qui prennent les armes contre la république. Plutôt qu’au « concept de transparence » (p. 55) qui est d’usage aujourd’hui (et peut avoir des connotations totalitaires), il aurait été préférable d’associer la vertu au concept de « publicité », puisque c’est cette notion qui est mise en avant par les contemporains et qu’elle renvoie à l’espace public démocratique (la vertu politique des représentants du peuple en étant une de ses conditions de possibilité).
Un chapitre est également consacré aux oppositions à la Révolution, le déploiement de la contre-révolution engendrant une répression qui s’intensifie lorsque le danger s’accroît, qu’il soit réel ou imaginaire. Il porte également sur la notion de « suspect », un terme qui apparaît dès 1789 et désigne des réalités très diverses, des suspects étant arrêtés dans les sections parisiennes bien avant la loi dite « des suspects ». Ce chapitre aborde enfin la question du « fédéralisme », un désignant politique mobilisé par la Montagne pour dénoncer l’usurpation du pouvoir législatif par certaines autorités locales, ce qu’il aurait été utile d’expliquer.
A propos des notions de loi ordinaire et loi révolutionnaire (un synonyme d’extraordinaire), Biard et Linton notent avec raison que « l’exception politique » pendant la Révolution ne peut être saisie à partir du paradigme « d’état/État d’exception » de Carl Schmitt. En revanche, contrairement à ce qu’ils semblent penser (p. 80), en 1793 la Convention ne perd pas son pouvoir constituant – et les attributions extraordinaires qui lui sont associées – parce qu’elle a voté une nouvelle Constitution, mais lorsque la nouvelle Constitution est mise en œuvre. Elle dispose donc toujours de ce pouvoir quand elle diffère la mise en œuvre de la Constitution de 1793 et institue un Gouvernement révolutionnaire jusqu’à la paix. Biard et Linton décrivent les institutions communément associées à la « Terreur » et à la Montagne (le comité de Salut public, les comités de surveillance, le tribunal révolutionnaire) qui sont toutes en place dès le printemps 1793 (sous la Convention girondine) et la loi du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) qui attribue le pouvoir exécutif des lois révolutionnaires aux autorités locales. Des programmes de recherche récents sur les comités de surveillance, des institutions locales qui ont un rôle clé dans la répression, montrent qu’ils sont modérés plutôt que « terroristes », certaines localités ne découvrant la « Terreur » que lorsque la presse thermidorienne commence à en parler.
Biard et Linton décrivent les luttes politiques et présentent les principales idées et caractéristiques des différentes « factions », en particulier les Girondins et les Montagnards. Ils mettent en avant la proximité des deux camps et leurs querelles fratricides alors que, selon eux (p. 100), « les historiens ont l’habitude d’affirmer qu’il y aurait des différences majeures d’origine sociale et d’idéologie entre Girondins et Montagnards », une note renvoyant à l’introduction de Soboul au colloque de 1980. Or, Soboul explique au contraire que les différences sont ténues, tous appartenant à la « bourgeoisie » révolutionnaire, partageant la même éducation et ne se distinguant que par la « stratégie », les Montagnards, contrairement aux Girondins, s’alliant avec le mouvement populaire. Seul Mathiez remet en cause cette lecture classique depuis Quinet et le concept de « révolution bourgeoise » qui lui est associé, essentiellement au XXe siècle. Comme Mathiez avait commencé à le montrer – et de nombreux travaux à sa suite – les luttes qui opposent la Gironde et la Montagne trouvent en grande partie leurs sources dans des conceptions divergentes de la république. Quand pour les premiers elle est instituée pour garantir la liberté des propriétaires, pour les seconds elle n’existe que pour garantir le droit à l’existence. Les luttes entre Montagnards et Girondins s’expliquent aussi par des choix de société radicalement différents.
Avant de proposer un « bilan de la Terreur » (p. 136) les auteurs décrivent ce qu’ils nomment le « cœur de la « Terreur » » (p. 119) constitué par Paris « épicentre de la « Terreur » » (p.127) et la Vendée. Ils interrogent notamment « la relation que les militants parisiens entretiennent avec la politique de terreur adoptée par la Convention de 1793 à 1794 » (p. 121). Ils mettent là encore en avant la dynamique de la peur, qui est à l’origine des « massacres de septembre » et de la justice révolutionnaire instituée pour éviter « la terreur improvisée » des sans-culottes (p. 124), une peur qui explique aussi la durée et les atrocités de la guerre civile (p. 135). Biard et Linton dressent le bilan d’une période à la fois fratricide et fraternelle (p. 143), cette dernière dimension, peu abordée dans le reste de l’ouvrage, étant davantage privilégiée dans le chapitre conclusif. Les archives montrent que le fonctionnement des sociétés populaires ne ressemble en rien à la « machine jacobine » que dénonçait Augustin Cochin (et non « Chopin », p. 145). Les pouvoirs locaux ne sont pas massivement purgés ni les assemblées locales dominées par une petite minorité. Les débats restent vivants, voire polémiques et il y a toujours, localement, des votes et des élections. Loin de la centralisation supposée, la loi du 10 juin 1793 donne la possibilité du partage des communaux (elle ne l’ « ordonne » pas, contrairement à ce qu’ils écrivent p.147) qui ont été restitués, la décision étant laissée aux assemblées d’habitants, c’est- à-dire aux hommes et aux femmes qui ont ici le droit de vote. La politique du maximum joue un rôle central dans la « terreur économique » (p. 151) en soumettant la liberté du propriétaire et du commerce au droit naturel à l’existence. Les auteurs rappellent également la politique d’accès à la terre et les décrets de ventôse qui doit l’accélérer, ainsi que l’abolition de l’esclavage qu’ils associent curieusement aux politiques de « bienfaisance » (p. 151).
Cet ouvrage est utile parce qu’il démonte certains clichés qui ont la vie dure et s’efforce de proposer un état des connaissances historiques. Il l’est également pour les interrogations qu’il suscite. La première concerne le mot terreur lui-même, dans sa signification et la typographie censée la restituer. Dans ce livre on trouve la Terreur, la terreur, « La Terreur », la « Terreur », la « terreur », chacune de ces variations pouvant être doublée par sa version en italique. Ainsi le chapitre 2 qui titre sur la « Terreur », traite dans sa première sous-partie de la Terreur, dans la deuxième de la « terreur » et dans la troisième de la terreur. Communément la « Terreur » désigne la catégorie politique thermidorienne, devenue un chrononyme et une catégorie historiographique, quand la terreur renvoie au sentiment de peur. Le reste est plus obscur et montre la difficulté qu’il y a à nommer cet objet historique lorsque l’on veut en restituer la complexité. Plus profondément, si la « Terreur » est une construction thermidorienne, que signifie le fait de rechercher le sens de « Terreur » avant thermidor et avant la Révolution ? Ne risque-t-on pas de projeter nos représentations de la « Terreur » sur l’Ancien Régime et de rassembler artificiellement ce qui pourrait entrer en résonance avec lesdites représentations ? Ne risque-t-on pas également de les projeter sur la Révolution (avant thermidor) comme c’est le cas depuis deux siècles ? N’est-ce pas finalement ce que font les auteurs lorsqu’ils évoquent la «politique de terreur adoptée par la Convention de 1793 à 1794 » (p. 121) ou dressent le « bilan de la Terreur » (p. 136) ? Enfin, si la catégorie de « Terreur » a été forgée par les thermidoriens n’aurait-il pas été pertinent d’en aborder toutes les dimensions ? Dans les années 1980, Jean-Pierre Faye proposait de penser ensemble et non de dissocier la « Terreur » et les Droits de l’homme, puisque les sources nous y invitent (3). Depuis, de nombreux travaux – dont les miens – ont documenté cette problématique. Nous savons par exemple que les thermidoriens qui fabriquent la « Terreur » comme un repoussoir, ne l’associent pas seulement à la guillotine mais aussi à l’anarchie dont ils situent la source dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Bentham le résume en 1795 lorsqu’il écrit que la Déclaration de 1789 dans son article 2 constitue le « langage de la Terreur ». En rendre compte aurait permis de « s’attaquer au phénomène de la « terreur » dans toute sa complexité et ses contradictions », selon les termes de Timothy Tacket à la fin de sa préface.
Notes :
(1) Michel Biard et Marisa Linton, Terreur ! La Révolution française face à ses démons, Paris, Armand Colin, 2020.
(2) Diane Ladjouzi, « Les journées des 4 et 5 septembre 1793 à Paris. Un mouvement d'union entre le peuple, la Commune de Paris et la Convention pour un exécutif révolutionnaire », AHRF, 2000, 321, p. 27-44. LIRE
(3) Jean-Pierre Faye, Dictionnaire politique portatif en cinq mots. Démagogie. Terreur. Tolérance. Répression. Violence, Paris, Gallimard, 1982.