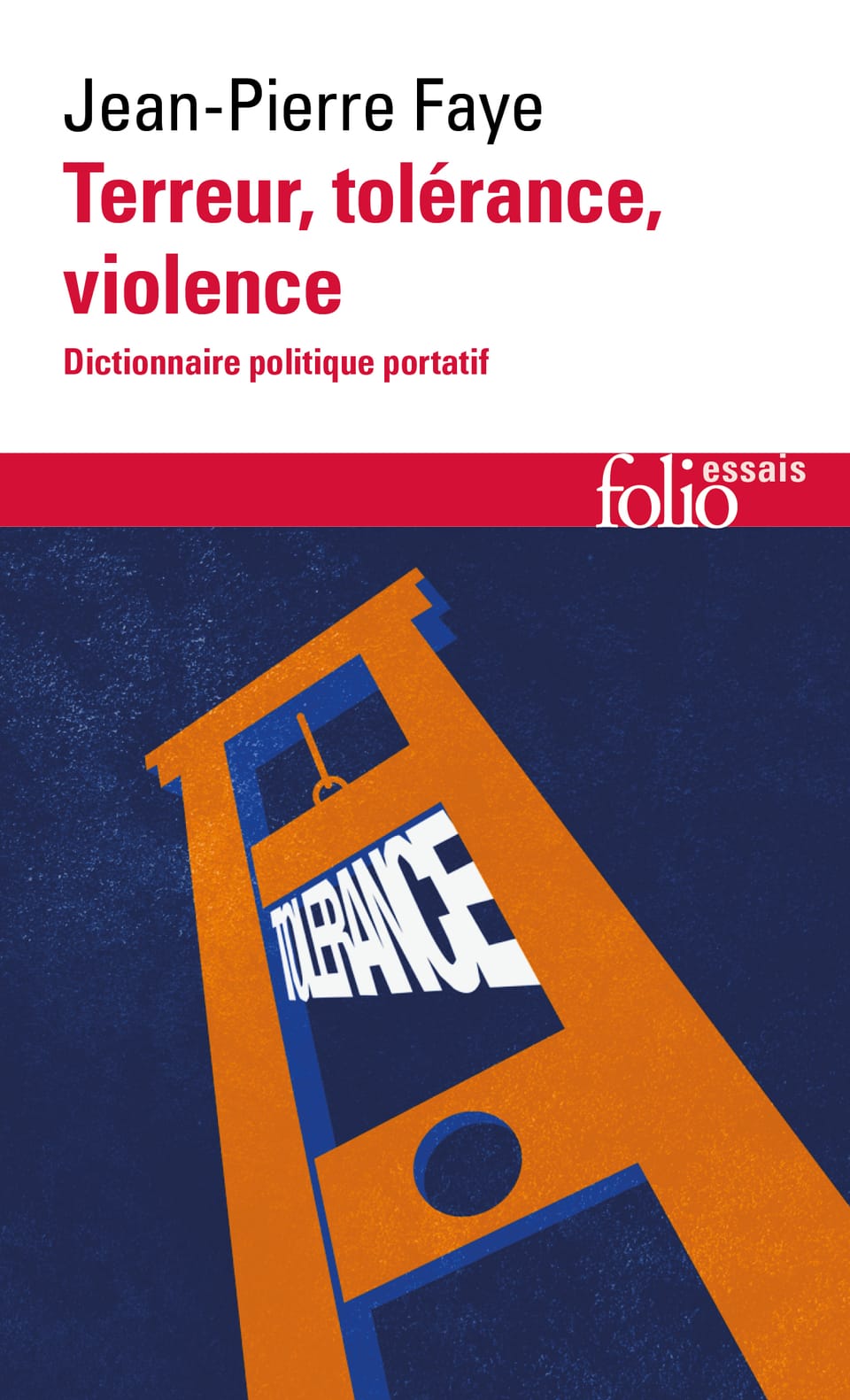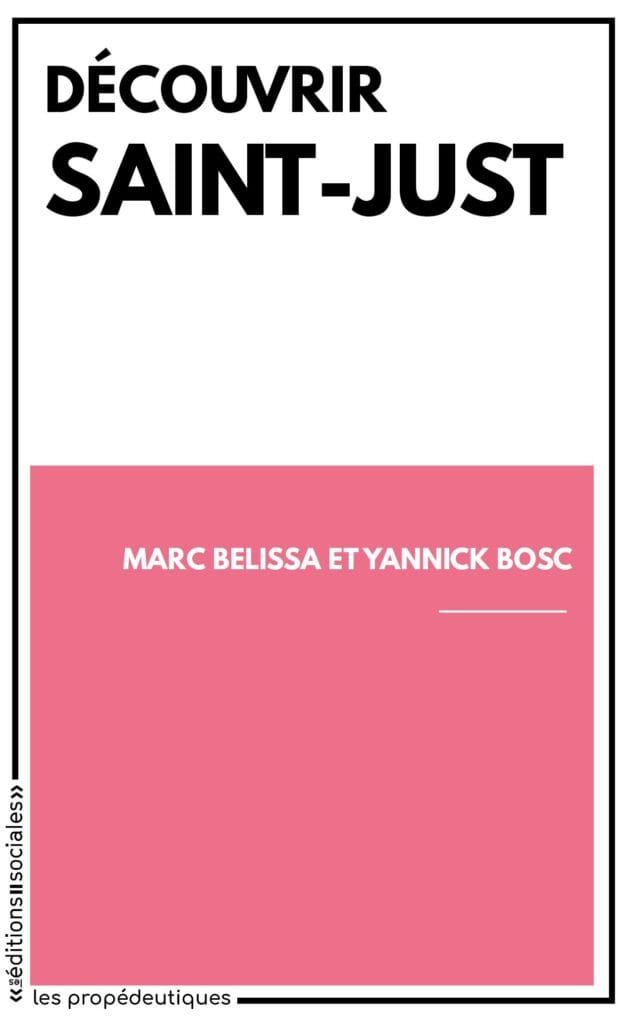La liberté contre le capitalisme
Introduction et table des matières de l'ouvrage de Yannick Bosc et David Casassas, La liberté contre le capitalisme. Le républicanisme du XVIIIe siècle et les révolutions à venir, Paris, Editions Critiques, 2024.

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 2
Nous connaissons ce récit. Nous en avons appris les rudiments à l’École et il organise nos représentations politiques. La Révolution française y est une révolution bourgeoise et les principes de la Déclaration des droits sacralisent la liberté du propriétaire. Ils sont le fondement juridique du capitalisme, c’est-à-dire de la modernité. D’un côté, il y a les droits-libertés qui s’affirment en 1789, de l’autre les droits-créances ou droits sociaux. Ces derniers concernent l’égalité et émergent plus tard : ce sont les droits de seconde génération. Les moyens des droits créances se situent dans le renforcement de l’État, ce qui constitue la base d’une politique de gauche. En revanche, une politique libérale (de droite) est, comme son nom l’indique, au service de la liberté économique et individuelle.
C’est ce récit que nous voulons interroger. On tend à le considérer comme un acquis à partir duquel il serait aujourd’hui pertinent de penser et d’agir politiquement. Nous l’appréhendons au contraire comme une construction idéologique qui entrave notre imagination politique et nous immobilise. Nous proposons donc de lui substituer un contre-récit, dans lequel les principes de la Déclaration ne sont pas ceux des « droits bourgeois », une politique de gauche n’est pas nécessairement étatiste et où la liberté et l’égalité sont pensées ensemble. Pour cela, nous disposons des ressources du XVIIIe siècle, un siècle au cours duquel l’idéologie capitaliste prend corps, mais aussi face à laquelle une autre conception de la « modernité » est élaborée. Nous aborderons cette critique du capitalisme naissant et le contre-récit qu’elle rend possible en nous appuyant sur trois figures du « siècle des Lumières » : Thomas Paine (1737-1809), Maximilien Robespierre (1758-1794) et Adam Smith (1723-1790). Le récit standard en a fait des personnages difficilement conciliables, le premier incarnant « la démocratie américaine » et les droits de l’homme, le second la « Terreur » révolutionnaire potentiellement totalitaire et le dernier la toute-puissance du « marché » débridé. Or, en dépit de ce qui les distingue, tous les trois partagent une même conception de la liberté, critique du capitalisme tel qu'il s'est déployé jusqu'à nos jours. Cette liberté prend corps dans une idée de la république que nous avons perdue et dont nous pensons qu’elle est aujourd'hui utile pour penser notre futur.
Le XVIIIe siècle n’est pas le XXIe siècle et les problèmes que nous rencontrons au XXIe siècle ne sont pas ceux du XVIIIe. Nous ne vivons pas dans le même monde. Nous sommes huit fois plus nombreux sur une Terre où le productivisme et la surconsommation sont devenus des questions majeures. Les femmes et les hommes du XVIIIe siècle plaçaient leurs espoirs dans une production qui permettrait de donner à la population les moyens d’exister et de consommer. Leur avenir n’était pas hanté par le changement climatique et rongé par le processus d’industrialisation, le capitalisme n’était pas dominant mais émergeant. En revanche, c’est à la fin du XVIIIe siècle que sont fixés les grands principes qui organisent toujours nos sociétés. Ils résultent de luttes d’une rare intensité dont la Révolution française est l’un des points culminants. Comme toujours, le récit des vaincus a été invisibilisé. Nous disposons donc de celui des vainqueurs, élaboré aux XIXe et XXe siècles, qui a accompagné et raconté le cycle productiviste ouvert au XVIIIe siècle. Paine, Robespierre et Smith, nous aident à déconstruire ce récit de la modernité qui confond le productivisme avec le progrès et le libéralisme économique avec la liberté. En cela, nous suivons une voie ouverte par un historien comme Quentin Skinner lorsqu’il étudie les républicains anglais du XVIIe siècle et leur demande ce qu’était La liberté avant le libéralisme1, c’est-à-dire avant que l’idéologie libérale n’en fasse sa chose. Skinner propose de chercher dans le passé ce qui nous permet de mettre à distance nos croyances et de les interroger. Il suggère en particulier d’en exhumer des principes que nous avons oubliés et des questions que nous ne posons plus mais grâce auxquels il serait possible de reconsidérer ce que nous en pensons. Comme le soulignait Marc Bloch, qui par ailleurs stigmatisait le « péché d’anachronisme », l’histoire s’écrit dans le présent de l’historien. C’est à partir de son présent qu’il problématise le passé. C’est à partir de nos questions du XXIe siècle que nous interrogeons le XVIIIe siècle, non pour y rechercher le même – notre vision du monde –, ce qui conduit à l’anachronisme, mais pour y étudier l’autre, une vision du monde que nous avons en grande partie oubliée.
Grâce à ce travail d’« archéologie » des concepts qu’il revendique, Quentin Skinner a montré qu’ il existait dans la tradition républicaine des XVIe et XVIIe siècles, en Italie et en Angleterre notamment, une idée de la liberté capable de concurrencer celle du « libéralisme»2. Cette dernière a été théorisée au tournant des XVIIIe et XIXe siècle, par Germaine de Staël puis Benjamin Constant. Dans le prolongement de la Révolution française et en réaction à la « Terreur », ils élaborent un modèle qui va organiser notre conception de la liberté politique pendant deux siècles. Celui-ci oppose la liberté des « Anciens » à celle des « Modernes ». Pour les premiers, expliquent-ils, c’est le fait d’agir en tant que citoyen qui nous rend libre alors que pour les seconds, c’est le fait que nos actions ne soient pas entravées. La liberté des Modernes est la liberté du « libéralisme ». Selon ce modèle, si la liberté des Anciens était adaptée aux mondes grec et romain de l’Antiquité, centrés sur la cité, elle est en revanche incompatible avec la « modernité », fondée sur l’individu, la production et le commerce, non sur la vie publique. Pour Germaine de Staël, Robespierre est un Ancien égaré dans la « modernité », agissant à partir d’une conception de la liberté puisée dans la tradition antique qui est inadaptée au XVIIIe siècle et dangereuse. La « Terreur » résulte ainsi de la mise en œuvre de la liberté des Anciens dans le monde des Modernes. Elle réside dans le fait d’attenter aux droits individuels (la liberté des Modernes) au nom de la vertu politique (la liberté des Anciens). Robespierre aurait ainsi entravé la liberté au nom de l’égalité et l’individu au nom du groupe (l’intérêt de la cité). Cette théorie libérale de la liberté est à la racine du récit selon lequel la Déclaration des droits de 1789 donnerait toute latitude aux propriétaires quant à l’usage de leurs propriétés – tel qu’il est fixé par le Code Napoléon – et serait en cela la justification en droit du capitalisme.
Quentin Skinner en histoire et Philip Pettit3 sur le plan de la théorie politique ont ébranlé ce schéma construit sur l’opposition de la liberté des Anciens et des Modernes – actualisé au XXe siècle par Isaiah Berlin4 – en mettant en avant une troisième conception de la liberté, plus ancienne que celle des libéraux et historiquement attestée : la liberté républicaine qui est conçue comme non-domination. Je suis libre si personne ne me domine et si je ne domine personne. C’est à partir de ce concept de liberté que Philip Pettit a construit les bases d’un néo-républicanisme qui permet aujourd’hui de se réapproprier un héritage républicain fort différent de celui que nous a légué l’histoire de France façonnée par la IIIe République. Cependant, Pettit et Skinner ignorent le XVIIIe siècle et la Révolution française comme ils laissent de côté la question économique et la question sociale, au sens des « droits sociaux ». Ils restent silencieux sur le processus d’appropriation et le droit à l’existence qui occupent une place déterminante chez les républicains de la seconde moitié du XVIIIe siècle5. Dans cet ouvrage, nous voudrions non seulement mettre en avant le fait qu’il existe une autre conception de la liberté que celle des « libéraux », mais surtout montrer que la conception républicaine de la liberté que nous observons dans la seconde moitié du XVIIIe siècle est incompatible avec la version « libérale », c’est-à-dire avec le « libéralisme » entendu comme idéologie du capitalisme. Parce que les sources nous y invitent, le républicanisme que nous évoquerons à travers Thomas Paine, Maximilien Robespierre et Adam Smith, sera profondément ancré dans les questions économiques, les problématiques de la propriété et du droit à l’existence et, pour cette raison, dans les questions politiques puisque pour ces républicains l’économie est politique. C’est parce qu’elle est politique que cette conception républicaine de l’économie est incompatible avec le capitalisme.
Qu’est-ce que le capitalisme ? Contrairement à ce qui est souvent affirmé, le capitalisme n’est pas l’échange marchand, il n’est pas le fait qu’il y ait des marchés et du commerce, de l’argent, des profits et des propriétés privées. Tout cela a toujours existé et le récit « libéral » consiste à affirmer que le capitalisme existerait de toute éternité, à l’image des marchés, du commerce et de la propriété privée. Il serait une forme naturelle de l’organisation humaine qui n’aurait pendant longtemps pas pu donner sa pleine mesure parce que la liberté était entravée par les archaïsmes des sociétés pré-modernes. Or, le capitalisme n’a pas toujours existé6. Le capitalisme n’est pas le commerce ou le marché, ni même la liberté du commerce, mais l’obligation de passer par le marché – par les relations marchandes – pour accéder aux moyens de subsistance. Le capitalisme se caractérise d’abord par la contrainte et repose sur le fait que tout devient marchandise. Il génère une économie prétendument désencastrée des sociétés, c’est-à-dire une économie qui fonctionnerait indépendamment des normes morales et politiques comme celles qui permettaient auparavant de la réguler7. Il s’agit d’un phénomène nouveau, théorisé à partir du XVIIIe siècle, qui est associé à une conception de l’économie pensée comme une science totale des sociétés, dans laquelle le marché se substitue au politique. Une économie républicaine telle que la conçoivent Paine, Robespierre et Smith, donc une économie qui est politique, implique au contraire d’encastrer l’économie dans la société ou, plus précisément, implique d’expliciter le fait que l’économie est toujours encastrée dans la société, la grande question étant de savoir qui régule cette économie et en faveur de qui. De manière complémentaire, et comme l’a montré Marx, le capitalisme consiste dans un rapport de domination (un rapport de classes), une autre raison pour laquelle il est, de fait, inconciliable avec le principe de la liberté républicaine définie comme non-domination. Cette domination a été rendue possible par la confiscation massive des ressources, un processus ouvert dès le XVIe siècle, qui s’est ensuite amplifié, et grâce auquel les moyens de production – la terre initialement – ont été concentrés dans quelques mains. Ce processus oblige les travailleurs à vendre leur force de travail comme une marchandise car elle devient la seule ressource dont ils disposent pour vivre. Dans leurs doléances adressées « au roi et à la nation assemblée » en 1789, les maîtres-ouvriers en soie de Lyon (les célèbres Canuts) qui voient se profiler cette perspective salariale et la fin de leur statut de producteurs indépendants, jugent qu’il s’agit là d’une condition d’esclave. De fait, la plantation esclavagiste a été un terrain d’expérimentation pour les premiers théoriciens du capitalisme8.
Afin de faire face à la rébellion et à l’organisation des dépossédés, le capitalisme a connu plusieurs mutations depuis le XIXe siècle. Dans le monde dit« développé », la principale a consisté à acheter la paix sociale grâceà l’extensionde la consommation et du crédit, un moyen de faire accepter la perte du contrôle sur nos existences, en d’autres termes d’accepter la domination (le travail contraint) tout en donnant de plus amples perspectives au productivisme. Au XVIIIe siècle, l’économie politique républicaine a engagé la critique de ce processus naissant de dépossession et de domination. Aujourd’hui, une approche républicaine de même nature consisterait à reprendre le contrôle de nos existences grâce à un contrôle des ressources. Les républicains du XVIIIe siècle nous aident à réfléchir aux modalités d’une réappropriation des moyens de production. Nous constaterons qu’elle ne passera pas forcément par une étatisation, telle que nous la concevons en général et telle qu’elle a été portée par les courants socialistes au XXe siècle. Le principe d’une propriété commune n’est pas celui de la propriété d’État– ce qui signifie pas que la propriété publique ne puisse être un moyen de concrétiser l'idée de propriété commune. La remise en question des mécanismes de domination, devrait également nous engager à interroger les moyens de son acceptation, ce que Marx appelle l’aliénation, donc interroger le productivisme et le consumérisme qui l’accompagne. Cela fait entrer dans l’équation le choix républicain de la « frugalité » ou de « l’aimable médiocrité » comme la nomme Robespierre, toutes choses caricaturées afin de pouvoir les juger passéistes et rebutantes – pensons au mythe du triste Robespierre face au Danton jouisseur – mais qui aujourd’hui résonnent avec le principe de « décroissance ». Nous verrons que pendant la Révolution française, le mouvement populaire et ses représentants s’appuient sur des normes républicaines, fondées sur le droit à l’existence, afin de réguler l’accumulation (de biens, de richesse), celle-ci n’étant possible que si elle ne met pas en danger le droit à l’existence d’autrui, une limite que le capitalisme a systématiquement transgressée.
Le productivisme est la clé de voûte du capitalisme, il est la raison et le moyen de la domination du travailleur, la condition du profit et du consumérisme. A l’échelle planétaire, et en dépit de la prise de conscience grandissante du fait qu’il n’est plus soutenable, le productivisme et l’extractivisme qui lui est associé se portent bien. Ils se portent d’autant mieux qu’une majorité de la population mondiale, si elle en a vu les dégâts, n’en a pas encore goûté les promesses. Dans ces conditions, il peut sembler aventureux de penser que le modèle productiviste qui naît au XVIIIe arriverait aujourd’hui en fin vie. Qu’il ait atteint ses limites, ne serait-ce que parce que les ressources de la planète ne sont pas extensibles et parce que la catastrophe climatique qu’il a engendrée finit par l’entraver, est devenu un constat de sens commun. Ces maladies auto-immunes du capitalisme ont été diagnostiquées de longue date, entre autres par Ivan Illich et André Gorz. On constate également qu’en dépit de l’énorme pression sociale et scolaire, l’acceptation par les nouvelles générations du statut de travailleur contraint ne semble plus aller de soi. Néanmoins, si le modèle est en bout de course, l’effondrement du productivisme lui-même n’est probablement pas pour demain. On peut même penser que le chaos qu’il provoque est devenu une des conditions de la survie du capitalisme. Générer et entretenir le chaos est un des moyens classiques de la domination et de la tyrannie, suivant le terme d’Hérodote ou d’Aristote, et face aux réponses de la tyrannie – aujourd’hui les fascismes et leurs succédanés – il est essentiel de concevoir et mettre en pratique des réponses démocratiques. Ne pas le faire aurait des conséquences catastrophiquement « dé-civilisatrices ».
Partir du principe selon lequel le modèle productiviste a épuisé ses potentialités nous incite à rejeter le récit libéral qui l’a accompagné pendant deux siècles, mais aussi à mettre à distance le récit socialiste tel qu’il a fini par être fixé au XXe siècle. Celui-ci partage en effet avec le libéral une même conception du progrès fondée sur le productivisme, mais un productivisme qui est supposément socialisé au lieu d’être privatisé. L’épuisement du paradigme productiviste conduit à l’obsolescence de ces deux idéologies antagonistes qui l’ont en partage, comme les deux faces opposées d’une même pièce. Tout nous engage à ne pas reproduire le monde dont nous avons hérité, et donc à nous séparer du « libéralisme » et de ce « socialisme » productiviste qui font partie de l’héritage. Cela signifie donc qu’il faut refonder les problématiques de la liberté et de la « question sociale » sur lesquelles le discours de ces deux traditions a été hégémonique.
Avec le « libéralisme » et le « socialisme » tel qu’il a été fixé au XXe siècle, nous sommes face à deux options politiques opposées dans lesquelles la liberté entre en tension avec l’égalité (le « social »). Accroître la liberté entraînerait inévitablement une augmentation des inégalités ; accroître l’égalité conduirait nécessairement à réduire la liberté. Par exemple, je ne dispose pas librement de mon argent si des impôts en prélèvent une partie pour le redistribuer. A condition de concevoir la liberté comme non-domination, et non comme absence d’entrave, il est possible de penser ensemble la liberté et l’égalité. C’est ce que permet la tradition républicaine. La perspective n’en est cependant pas immédiate car, dans l’héritage, on trouve également une idée très appauvrie voire inversée de la république. Au Chili, les nostalgiques de Pinochet ont fondé le Parti Républicain, c’est aux États-Unis celui de Donald Trump et en France Les Républicains rassemblent la droite conservatrice. Si telle est l’idée de république, on voit effectivement mal en quoi elle serait subversive du capitalisme. De fait, aux yeux de nos contemporains, la république n’incarne pas la subversion. En France plus particulièrement, elle est devenue le masque de l’autoritarisme et le support de ce que Jean-Fabien Spitz appelle « un nouvel intégrisme politique » qui instrumentalise la laïcité à des fins identitaires et renforce les rapports de domination9. « L’ordre républicain » est maintenu grâce à la violence exercée contre ceux qui en contestent la nature de classe et la logique post-coloniale.
Les représentations les plus ordinaires de la république puisent principalement leurs racines dans la Troisième République, celle de Jules Ferry. C'est à elle – plus précisément à son mythe – que la grande majorité des politiques qui, en France, se réclament aujourd'hui de l'idée républicaine se réfèrent communément, en particulier lorsqu’ils en brandissent les « valeurs ». En revanche, ses devancières, la Première (pendant la Révolution française) et la Deuxième (1848), sont la plupart du temps renvoyées à des curiosités historiques. Elles font figure de brouillons républicains dans lesquels il serait vain de chercher une quelconque aide concrète pour penser le monde d'aujourd'hui, la Première République entre 1793 et 1794 ( l’an II de la République) ayant de surcroît l'inconvénient majeur d'être caractérisée par la « Terreur ». C'est pourtant à cette Première République « terroriste » que nous nous référerons lorsque nous évoquerons la tradition républicaine démocratique de la Révolution française. Entre 1789 et 1794, tous les acteurs, qu’ils soient royalistes ou républicains – et, parmi ces derniers, Girondins ou Montagnards – brandissent la terreur, au sens de la crainte que doivent ressentir leurs ennemis, une terreur qui est à la mesure de la répression dont les ennemis sont l’objet. En revanche, la notion de « Terreur », entendue comme un système politique dont on attribue la conception à Robespierre, est une construction postérieure. Ce sont ceux qui font exécuter Robespierre et mettent fin à l’expérience républicaine de l’an II qui la désignent comme un « système de terreur », ce que l’historiographie fixera sous le terme de « Terreur », avec un grand « T »10. La construction des désignants « Terreur » et « terroriste » a été un moyen très efficace pour occulter la nature de cette expérience républicaine. Depuis cette époque, l’accusation de « terrorisme » est un outil classique de la disqualification politique. En dépit du stigmate, la tradition républicaine démocratique a eu des héritiers. Elle a en partie été incorporée dans les premiers socialismes avant de disparaître à la fin du XIXe siècle sous le poids d’un marxisme standardisé. C’est ce dernier stade que Antoni Domènech a nommé L’Eclipse de la fraternité11. C’est cette tradition alors en déshérence que des historiens marxistes critiques vont s’efforcer d’exhumer, voire de réactiver, comme Albert Mathiez dans la première moitié du XXe siècle ou E.P. Thompson pour la seconde. Nous marchons sur leurs traces.
Le fait que la notion de république et les principes républicains soient falsifiés n’est pas une chose nouvelle puisqu’ils le sont d’emblée. A l’automne 1795, alors que ceux qui viennent d’éliminer les « terroristes » instituent une république des propriétaires, Gracchus Babeuf juge que les mots république, liberté, égalité, sont devenus « l'inverse de la définition du dictionnaire »12. On notera que ce sont des proches de Babeuf – et de Robespierre –, comme Philippe Buonarroti, qui relient la tradition républicaine démocratique du XVIIIe siècle et la tradition socialiste du premier XIXe siècle. Ils veulent témoigner d’une certaine idée de la république démocratique et sociale face à des classes dominantes qui s’efforcent de l’éradiquer par la répression physique, mais également par celle du langage. L’invention de la « liberté des Modernes » et du « libéralisme » est une étape décisive de ce processus de confiscation de la langue politique et d’invisibilisation de la liberté républicaine. Contrôler le sens de la liberté, mais aussi de la propriété, de la souveraineté ou encore de l’ État est évidemment un enjeu fondamental. C’est à travers ces mots que nous organisons nos sociétés et définissons les lois qui les régissent. La Révolution a été un des grands moments de la lutte pour le contrôle du sens des catégories politiques, Robespierre n’ayant de cesse de dénoncer ce qu’il qualifiait d’ « abus des mots ». A l’ère du « storytelling », des vérités alternatives et d’un empoisonnement généralisé du langage, il devient urgent de se réapproprier les catégories à partir desquelles nous souhaitons construire notre monde et grâce auxquelles d’autres le détruisent13. C’est ce que nous proposons dans cet ouvrage dont les chapitres sont articulés autour de quelques notions-clés.
Comme il se doit, nous partons de la liberté(chapitre 1), telle qu'elle est mobilisée par les courants républicains au XVIIIe siècle, que nous confrontons à la liberté du « libéralisme ». Alors que la liberté « libérale » est un attribut de l'individu atomisé, la liberté comme non-domination est un rapport social : je suis libre parce que les autres le sont aussi. Une liberté effective va alors de pair avec l'affirmation d'un droit égal à la liberté.
Cela a d’importantes conséquences sur la propriété (chapitre 2). Des républicains comme Robespierre ne sont pas hostiles à la propriété et ne cherchent pas à l'éradiquer au nom de l’égalité. En revanche ils dénoncent une conception de la liberté selon laquelle le propriétaire pourrait jouir sans entrave de sa propriété, c'est-à-dire au détriment de l'existence d'autrui et donc de la liberté d'autrui. En raison de cette idée de la liberté, ils considèrent que les biens qui permettent de vivre ne doivent pas être abandonnés à la violence du marché mais constituent une propriété sociale commune. Les marchés sont donc des objets politiques.
Le républicanisme d’Adam Smith nous incite également à penser les marchés comme des institutions politiquement constituées qui, à condition d’en avoir le courage politique, peuvent être mises au service d’une démocratisation de la vie économique et sociale (chapitre 3). L'économie politique d’Adam Smith, loin de faire l’apologie du capitalisme, nous propose au contraire des outils grâce auxquels le condamner et le dépasser.
Au XVIIIe siècle, l’indispensable régulation républicaine des marchés ne rime pas nécessairement avec un État fort et centralisé qui serait en charge de leur contrôle (chapitre 4). A l'encontre de l'idée communément admise, le « jacobinisme » des origines n'est pas centralisateur. Le pouvoir exécutif est pensé pour être exercé au plus près de la population et sous sa surveillance, dans les communes. Il n’est pas la chose d’une administration et de ses experts concentrés dans les ministères de la capitale. L’idéal républicain est celui d’un peuple qui se gouverne et s’administre lui-même ou par le truchement de mandataires ou de commis qu’il contrôle étroitement.
Ce contrôle est un attribut de la souveraineté populaire. Elle repose sur des principes politiques, fondés dans le droit naturel, dont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est l’expression. Ce sont ces principes que Thomas Paine caractérise comme étant de sens commun (chapitre 5). Au XVIIIe siècle, le sens commun et l’idée de république démocratique qui l’accompagne entrent en conflit avec les préjugés des élites du savoir et de la richesse qui se jugent seules expertes, c’est-à-dire seules aptes à définir l’intérêt général et les politiques censées y mener.
A quelle condition demande Thomas Paine, pouvons-nous estimer que nous constituons une société civilisée ? A condition, répond-il, que tous les individus qui la composent disposent du droit à une existence digne. Cela implique d’avoir un accès inconditionnel aux ressources qui ont été confisquées et sans lesquelles il n’est pas possible de mener une existence digne (chapitre 6). Pour faire face à la dépossession et à la domination qu’elle engendre, Paine propose le principe d’allocation universelle et inconditionnelle. Il participe d’une république conçue comme un bien commun, constitué par une société d'êtres humains libres et égaux. Elle est également un mode de gouvernement en commun de ce bien commun qui consiste dans la mise en œuvre des principes du droit naturel. L’intérêt général n’y est pas l’affaire d’un appareil d’État mais des citoyens. Le républicanisme démocratique du XVIIIe siècle nous engage ainsi à retrouver la dimension subversive de la Déclaration de 1789 – qui en France fait partie du bloc de constitutionnalité – et de la Déclaration universelle de 1948 qui s’en inspire et la complète. Il nous incite à « faire parler la loi »14 dans le sens du bien commun et non de l’intérêt des puissants, donc à résister à l’oppression du capitalisme et à bâtir des formes d’interdépendance entre des êtres humains effectivement libres.
Notes
1Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme, (1998), trad. Paris, Seuil, 2000.
2Quentin Skinner, « Un troisième concept de liberté au-delà d'Isaiah Berlin et du libéralisme anglais », (2001), trad., Actuel Marx, 2002/2, n°32, p. 15-49.
3Philip Pettit, Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, (1997), trad., Paris, Gallimard, 2004.
4Isaiah Berlin,Two concepts of liberty, Oxford, Clarendon Press, 1958.
5Jean-Fabien Spitz, « Le néo-républicanisme, un programme politique pour aujourd’hui ? », Olivier Christin dir., Demain la république, Lormont, Le Bord de l’eau, p. 53-76.
6Ellen Meiksins Wood, L'origine du capitalisme. Une étude approfondie, (2002), trad., Montréal, Lux Editeur, 2009.
7Karl Polanyi, La Grande Transformation, (1944), trad. Paris, Gallimard, 1983.
8Florence Gauthier, « À l'origine de la théorie physiocratique du capitalisme, la plantation esclavagiste. L'expérience de Le Mercier de la Rivière, intendant de la Martinique », Actuel Marx, 2002/2, 32, p. 51-72.
9Jean-Fabien Spitz, La République ? Quelles valeurs ? Essai sur un nouvel intégrisme politique, Paris, Gallimard, 2022.
10Françoise Brunel, Thermidor. La chute de Robespierre, Bruxelles, Éditions Complexe, 1989 ; Marc Belissa et Yannick Bosc, Robespierre. La fabrication d’un mythe, Paris, Ellipses, 2013 ; Cesare Vetter, « « Système de terreur » et « système de la terreur » dans le lexique de la Révolution française », Révolution française.net, octobre 2014, en ligne.
11Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad: Una revisión republicana de la tradición socialista, (2004), rééd., Madrid, Akal, 2019.
12Le Tribun du peuple, n°34, 15 brumaire an IV (6 novembre 1795), p. 8.
13Jean-Pierre Faye, Langages totalitaires. Critique de la raison narrative, critique de l'économie narrative, (1972), rééd., Paris, Hermann, 2004.
14Jacques Guilhaumou, La parole des sans. Les mouvements actuels à l’épreuve de la Révolution française, Fontenay-aux-Roses, ENS Éditions, 1998, p. 41.
Table des matières :
Chapitre 1 - La liberté contre la liberté
Chapitre 2 - La propriété contre la propriété
Chapitre 3 - Le marché contre le marché
Chapitre 4 - L'Etat contre l'Etat
Chapitre 5 - L'expertise contre l'expertise
Chapitre 6 - La civilisation contre la civilisation