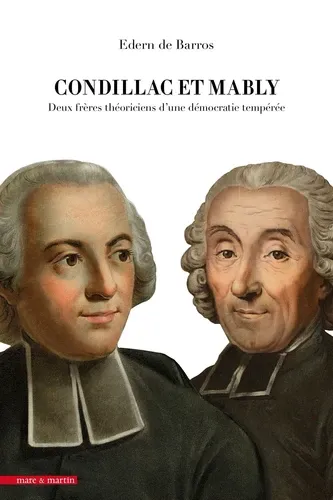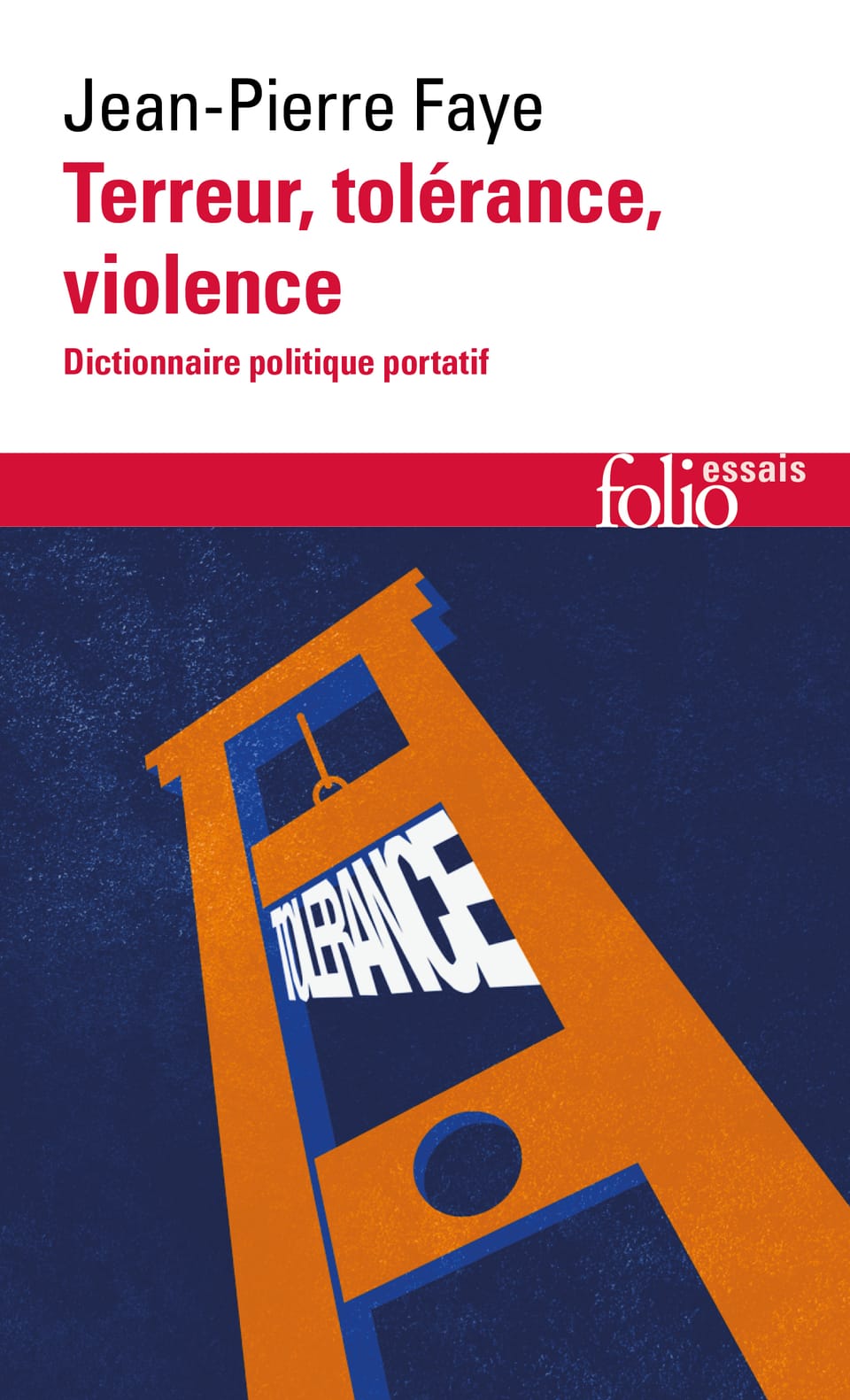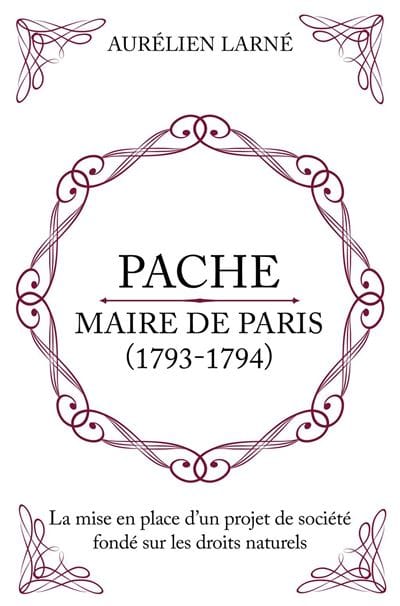Les Amis de Robespierre. Conférences
Cycle annuel de conférences 2025-26 de l'ARBR, à Arras. Accessible en visioconférence.
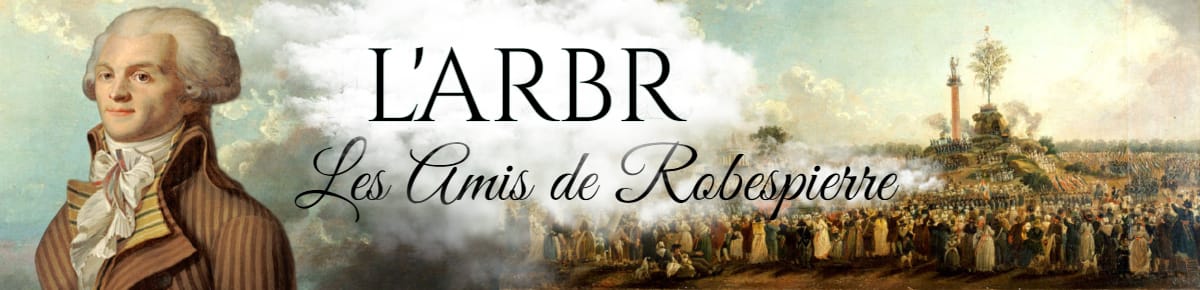
Présentation :
" Cette année, l’ARBR s’honore de proposer au public arrageois son cycle annuel composé de 9 conférences pour l’année scolaire 2025-2026.
Il s’agira, comme ceux des années précédentes, d’appréhender « les réalités de la Révolution française », la place et le rôle des humbles.
Nous nous félicitons cette année d’accorder, pour cela, une large place à de jeunes chercheurs -- doctorants ou thésards récents – acteurs de l’actualité de la recherche consacrée à la période qui nous occupe depuis près de 40 ans.
Qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement et leur disponibilité. Arras saura leur réserver le meilleur accueil.
J’y associe nos hôtes, l’Office Culturel et la proviseure et les personnels de la Cité Scolaire Gambetta Carnot, qui nous permettent de vous accueillir dans de bonnes conditions.
Je le rappelle : nos conférences sont accessibles gratuitement à tout public. Nos conférenciers ont le souci, qui est le nôtre, de faire œuvre d’éducation populaire et de faire partager leur passion à tous les citoyens.
Comme les années précédentes, elles seront accessibles en visio-conférence puis mises en ligne sous forme de film sur notre site.
Comme vous pourrez le lire, notre choix accorde une large place au rôle des femmes, pendant et avant la Révolution ; et les thématiques proposées éclairent l’actualité.
Nos conférences s’adressent également, et tout particulièrement, aux lycéens, aux étudiants à leurs enseignants. Elles viendront compléter et illustrer, à point nommé, divers points des programmes scolaires de l’éducation civique et morale. Qu’il s’agisse du consentement (la galanterie) ou de l’importance des évènements mémoriels (Panthéon) ou de celle d’utiliser les mots justes. (les mots de la révolution.
Au plaisir de vous accueillir."
PROGRAMME :
Vendredi 12 septembre 2025 à 18 h 30 Médiathèque de Vermand (02)
Alcide CARTON
Président de l’ARBR, Inspecteur honoraire de l’Éducation Nationale
ROBESPIERRE QUI ÉTAIT-IL VRAIMENT
De quoi Robespierre est-il encore le nom ?
Assimilé à la guillotine et à la terreur depuis deux siècles et demi y compris dans les manuels d’histoire, pour beaucoup, mais symbole, « vox populi » dans le monde du travail progressiste et les opprimés pour qui il incarne une certaine idée de la justice pour le peuple, celle d’un incorruptible défenseur des faibles autant contre ceux qui substituèrent le pouvoir de l’argent à celui des ordres monarchiques, que contre les ennemis de la patrie, enfin, celui de l’homme du peuple et de la vraie révolution.
Alors, je vais essayer devant vous de répondre à la formule de Marc Bloch, grand historien du vingtième siècle fusillé par les nazis,
« Robespierristes, anti-robespierristes, de grâce, dîtes enfin qui fut Robespierre ».
Samedi 4 octobre 2025 14 h 30 à la Cité scolaire Gambetta-Carnot
Florence Gauthier
Historienne des Révolutions en France et en Haïti (MCF-HDR honoraire)
GALANTERIE À LA COUR ET AMOURS PAYSANNES DANS LES PRÉS
« Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui »,
La Bruyère, Les Caractères, De la Société, 1688.
La période moderne se confond avec l’essor de la galanterie, soit une politique de civilisation des rapports entre les sexes. Elle fut introduite dans le Royaume de France par François Ier qui la rencontra en Italie, chez la duchesse d’Urbino, et décida de l’introduire à sa cour. Elle régressa sous l’effet des Guerres de religion, durant lesquelles elle se réfugia dans des hôtels particuliers, puis réapparut à la cour sous Louis XIII pour triompher sous Louis XIV. Au siècle suivant, elle fut combattue par le libertinage, la débauche et les débuts du romantisme, mais offrit aussi des prolongements avant de tomber dans l’oubli.
A la cour de François Ier, les femmes se virent confier la tâche de civiliser "les nobles soudards illettrés et les clercs misogynes" par des moyens multiples : la séduction, le commerce spirituel, la culture et ses langages, la valorisation de l’amour et du plaisir.
La mixité fut une première conquête et, au XVIIe siècle dans ce royaume, les femmes se trouvent partout, dans les rues et les salons, à la cour et peuvent s’adresser à un galant homme sans déshonneur. Les hommes doivent apprendre à faire confiance aux femmes, ce qui a demandé, des deux côtés, un apprentissage : ce sont les femmes qui se gardent elles-mêmes et cette confiance réciproque offre les conditions de l’estime et de l’amour. Les galants hommes ont encore appris à parler de tout devant et avec elles.
La préciosité, avec Madeleine de Scudéry, a valorisé le droit des femmes à disposer d’elles-mêmes et affirmé la propriété de leur corps, ce qui constitue une immense conquête, qui a contribué à construire non seulement l’égalité entre les deux sexes, mais aussi leur désaliénation réciproque. Elle a rendu l’amour et la sexualité « précieux » et honorables, et leur a donné, à une époque où l’orgasme était considéré comme une fonction vitale mais qui appartenait au « bas corporel », le rôle de recéler les secrets de l’âme.
A la même époque, les cartésiens associaient les femmes à leurs travaux, pas seulement comme auditrices, mais comme savantes :
« C’est pourquoi il n’y a aucun inconvénient que les femmes s’appliquent à l’étude comme nous. Elles sont capables d’en faire aussi un très bon usage… » (Poulain de la Barre, p. 78).
La galanterie appartient au monde profane de la gaieté et de la joie de vivre, mais aussi de l’excitation que produit la mixité et la possibilité de séduire et de charmer. La liberté des femmes consiste encore à avoir une vie sociale, à parler avec des hommes qui ne sont pas seulement des proches. Elle a généré une érotisation sociale en permettant de parler d’amour publiquement, comme d’une passion commune au genre humain, et pas seulement sur le registre de la singularité sans partage...
Qu’est-ce que la galanterie ? Je me propose de présenter ce que fut cette politique de civilisation des rapports entre les sexes et son indéniable présence dans les mœurs, les arts, la culture et la politique de l’époque moderne.
Et enfin, de parler de la clef de cette culture qui se trouve dans les Amours paysannes…
Samedi 8 novembre 2025 à 14 h 30 à l’Office culturel d’Arras
Brigitte DIONNET
Docteure en Histoire contemporaine.Thèse soutenue sous la direction de Pierre Serna
QUAND DES INVISIBLES, LES PARISIENNES PAUVRES, CRÈVENT L’ÉCRAN DE L’HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION
Invisibles, les parisiennes pauvres ne l’étaient pas pour leurs contemporains, comme le journaliste L S. Mercier le déplorait : il écrivait que les femmes « veulent être absolument où la nature ne veut pas qu’elles soient ». Ce qui s’est avéré être une réalité. Citoyennes avant d’être mères, elles n’en furent pas moins des citoyennes mères et des travailleuses. La double peine de leur genre et de leur situation sociale les amenèrent à déployer une « agentivité » porteuse de révolution en donnant un caractère singulier au processus révolutionnaire.
Samedi 10 janvier 2026 à 14 h 30 à l’Office culturel d’Arras
Jean-Loup Kastler-Vassilievitch
Ancien élève de l’école normale supérieure de Lyon, Doctorant à Paris sous la direction de Pierre Serna
LA JOURNÉE DES TUILES DU 7 JUIN 1788 : LES HERBIÈRES GRENOBLOISES ET LA QUESTION DES BIENS COMMUNS EN RÉVOLUTION.
La communication revient sur la Journée des Tuiles de 1788, souvent présentée comme prélude à la Révolution française, mais ici réinterprétée à partir des résistances populaires grenobloises. L’auteur propose le concept d’« écologie morale de la foule », qui désigne les pratiques de survie et les résistances des classes modestes face aux privatisations des communaux. Les femmes, et particulièrement les herbières, jouent un rôle central : vivant du glanage, du jardinage précaire ou du commerce de plantes médicinales, elles sont directement touchées par la répression monarchique. Leur implication dans les émeutes témoigne d’une résistance écologique et sociale.
La découverte récente d’une nouvelle source, corroborant le célèbre témoignage du « religieux anonyme », confirme leur importance dans la Journée des Tuiles. Ces femmes ne sont plus seulement spectatrices mais véritables actrices, forçant même les parlementaires à siéger le 7 juin 1788. La mémoire de leur rôle a longtemps été minimisée voire moquée, mais elle réapparaît aujourd’hui, notamment par une plaque commémorative à Grenoble. L’étude replace aussi cette lutte dans un cadre juridique ancien (arrêt de 1477) qui légitimait les droits collectifs sur les communaux.
Ainsi, la Révolution à Grenoble apparaît non comme une simple réaction aux décisions parlementaires, mais comme l’aboutissement d’une longue résistance populaire, où se croisent luttes écologiques, sociales et féminines. La figure de la sorcière, réhabilitée dès la fin du XVIIIe siècle, incarne symboliquement cette résistance.
Jeudi 5 février 2026 à 18 h 30 à l’Office culturel d’Arras
Hervé LEUWERS
Professeur d’Histoire de la Révolution à l’Université de Lille III
LES MOTS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
La Révolution s'opère par des actes, mais aussi par des mots. Dès 1790, le grammairien Chantreau s'étonne de l'impact des transformations en cours sur l'usage de certains termes ; les uns s'effacent (cens, seigneur, dîme), quand d'autres s'enrichissent de nouvelles acceptions (citoyen, aristocrate) ou apparaissent (lèse-nation, cocarde nationale). En revenant sur cette révolution des mots, et sur la manière dont elle a été perçue par les contemporains, la conférence rappellera comment le bouleversement politique, social et culturel des années 1790 transforme le vocabulaire en usage, mais aussi combien une partie des mots nouveaux s'efface dès le Consulat, et même avant. Les mots, d'une certaine manière, invitent à explorer autrement la Révolution française et ses legs.
Samedi 14 mars 2026 à 14 h 30 à l’Office culturel d’Arras
Gauthier BAERT
Doctorant à L’Université de Lille sous la direction de Hervé Leuwers
L'USAGE DES DONS PATRIOTIQUES, UNE PRATIQUE CIVIQUE QUI RENVOIE À LA VERTU RÉPUBLICAINE
Il s'agira, en une heure, tout d'abord, de présenter, en introduction, ce que sont les dons patriotiques, à travers une comparaison de définitions de l'époque.
La présentation se déroulera ensuite en deux parties :
I – Le sacrifice sur l’autel de la patrie, autrement dit l’étude d’une pratique civique.
II – Une manifestation de la vertu républicaine, autrement dit la signification de ce geste à l'aune de l'esprit public.
Il s'agira en conclusion d'affirmer le lien entre la pratique des dons patriotiques et l'essor de l'esprit républicain.
Samedi 4 avril 2026 à 14 h 30 à l’Office culturel d’Arras
Edern DE BARROS
Maître de conférences en Histoire du droit.
MABLY : HISTORIEN DE LA DÉMOCRATIE ET THÉORICIEN DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
Frère du philosophe Condillac, Mably (1709–1785) est l’un des penseurs politiques majeurs du XVIIIe siècle. D’abord publiciste à la cour, il s’oriente dès les années 1750 vers une relecture critique de l’histoire de France à travers le prisme des institutions germaniques. Inspiré par Montesquieu, il voit dans les champs de mars mérovingiens et les champs de mai carolingiens l’origine d’une démocratie tempérée fondée sur la participation du peuple aux lois.
Contre les tenants du droit romain et les partisans de l’absolutisme, Mably défend une histoire populaire de la souveraineté, fondée sur un régime mixte équilibrant peuple, grands et roi. Il s’oppose aux physiocrates et à leur conception d’un despotisme légal au nom des « lois économiques naturelles ». Dans Du commerce des grains (1775), il prend la défense des classes populaires face à la libéralisation autoritaire menée par Turgot.
Son œuvre vise à politiser la mémoire nationale et à rappeler que le peuple français a longtemps exercé un rôle actif dans les affaires publiques. Ce travail de réhabilitation historique, que Jean-Pierre Faye a qualifié d’« effet Mably », a directement inspiré les révolutionnaires de 1789. Selon Jean Carbonnier, Mably fut ainsi « le parfait maître ès lois de la Révolution française »
Samedi 30 mai 2026 à 14 h 30 à la Cité scolaire Gambette-Carnot
Michel BIARD
Professeur d’Histoire honoraire à l’Université de Rouen
LE PANTHÉON, DE MIRABEAU À MARC BLOCH (1791-2026), UNE HISTOIRE POLITIQUE MOUVEMENTÉE.
Créé par la Révolution, le Panthéon n'abrite plus qu'une poignée de ses protagonistes, aucun des révolutionnaires panthéonisés en 1791-1794 ne s'y trouvant encore. Qui sont les « grands hommes » qui y reposent aujourd’hui, qui a décidé de leur panthéonisation et pourquoi ?
Samedi 20 juin 2026 à 15 h 00 à l’Espace Saint-Eloi, Salle Marcel Roger
Elise MEYER
Docteure en histoire contemporaine Université de Rennes II
LA MÉMOIRE DE LA BATAILLE DE VALMY DE 1792 À NOS JOURS
Si les lieux de mémoire vivaces au sein de la société française sont traités par les historiens depuis les années 1980, ceux qui ont sombré dans l'oubli sont encore souvent laissés de côté. C'est le cas de la bataille de Valmy, dont le souvenir a été abondamment évoqué au cours de la IIIe République, puis délaissé après la Seconde Guerre mondiale. La mémoire de cette bataille est d'autant plus intéressante qu'elle a suscité de nombreux débats depuis son déroulement, en 1792. Valmy, c'est un combat truqué pour les royalistes légitimistes, un emblème du roi Louis-Philippe, une victoire du peuple pour les socialistes ; l'étudier revient à analyser comment un événement devient un mythe. La bataille de Valmy n'est pas seulement une date dans l'Histoire : c'est un argument éminemment politique.